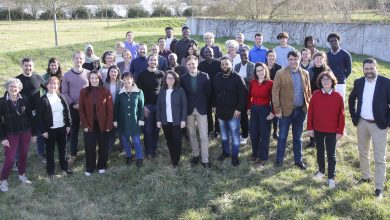Luce Lefebvre-Goldmann, portrait d’une incombustible

Au commencement, il y a Lisieux, un printemps de 1996, et une enfant déjà promise à la lumière autant qu’au chaos. Luce Lefebvre-Goldmann naît le 22 mai, de Dominique Lefebvre et Laure Fournier. Très tôt, le destin s’invite avec fracas : à peine venue au monde, sa mère souffre de ce que les psychiatres appellent alors une psychose puerpérale, et son père est incarcéré pour abus de confiance. L’équilibre vacille, mais déjà, une autre force s’installe : celle de la survie, cette lucidité précoce qui deviendra plus tard une forme d’art.
Durant ces premiers mois, Luce passe de bras en bras : ses grands-parents l’accueillent, sa mère se soigne, son père purge sa peine. « Quand ma mère m’a revue après trois semaines, dit-elle, elle m’a dit que mon regard avait changé. » Cette phrase, simple, devient presque un symbole : la conscience, si jeune déjà, d’un monde où rien n’est jamais stable.
Lorsque Luce a un an et demi, un autre visage du hasard s’ouvre. Laure retrouve Philippe, rencontré des années plus tôt au lycée français de Rome. Il l’appelle, insiste, jusqu’à ce qu’elle cède — par lassitude d’abord, puis par tendresse. « Elle s’est dit : comme ça, il va arrêter de me casser les… et puis finalement, ils ne se sont plus quittés. » Luce grandit ainsi entre Chaville et Paris, sous la protection d’un homme qu’elle considérera toujours comme son père.
De cette enfance marquée par les départs et les retours, il reste un fil de lumière : un père joueur, attentif, presque magique. « Il me portait sur ses épaules, et devant la tour Eiffel, il faisait semblant de la faire s’allumer en se concentrant très fort. J’ai compris plus tard qu’il connaissait juste les horaires. » Philippe est monteur, passionné de cinéma, premier rôle de L’Argent de poche de François Truffaut, sorti en 1976. Il transmet à sa fille l’amour des images et du rythme, sans jamais céder à la facilité. À la maison, pas d’écran, peu de bruit : on lit, on regarde du Truffaut justement, la Nouvelle Vague, The Blues Brothers. Luce n’aura jamais vu Harry Potter, mais elle connaîtra par cœur les plans de Jules et Jim.
Du père biologique, elle ne garde qu’une silhouette fuyante. « Je le voyais encore un peu jusqu’à mes cinq ans et demi, mais quand ma sœur Claire est née, il a coupé tout contact. » À cet âge où l’on comprend déjà trop, l’abandon s’imprime. Elle continue pourtant d’écrire à ses frère et sœur aînés, enfants d’un premier mariage. À dix ans, un appel d’Aurélie, sa grande sœur, apprend la mort de Dominique, survenue deux ans plus tôt. Personne ne les avait prévenus.
Peu après, Philippe l’adopte officiellement. Lefebvre-Goldmann : les deux pères réunis en un nom, la filiation recomposée par la tendresse. « C’était une belle cérémonie, très émouvante. Je ne me souviens pas d’avoir vécu sans Philippe. » Cette adoption plénière, ce geste de droit et d’amour, devient le socle sur lequel Luce se construit.
Les premières fractures
Mais la stabilité demeure fragile. Après la naissance de sa petite sœur, sa mère retombe malade. Nouvelle hospitalisation. La scolarité suit son cours : des capacités évidentes, un esprit vif, une inadaptation au cadre. Au collège, elle rencontre Anastasia, une amie comme une sœur. « On était un peu toutes les deux, et le reste du monde. » Anastasia est brillante, solaire, mais marquée par la tragédie : son père et son frère se sont suicidés. Entre elles, une complicité absolue — jusqu’à une rupture, soudaine, incomprise, dont l’écho résonne encore. Trois mois plus tard, Anastasia met fin à ses jours. « On ne se parlait plus, je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais bien sûr que ça m’a marquée à jamais. » Luce s’enfonce dans la fumée du cannabis, puis plus loin encore. « Je n’envisageais pas de sortir sans avoir de quoi fumer. » La scarification devient un langage, la douleur un refuge pour se sentir exister.
L’adolescence, l’amitié, la perte
L’adolescence se déroule ainsi : brillante, fragile, rebelle. Elle décroche du système scolaire, trouve absurde l’analyse littéraire : « Grand I, grand II, grand III, pour moi ça n’avait aucun sens. L’art, c’est l’émotion, pas la dissection. » Le bac littéraire, elle s’y présente mais rend copie blanche. Puis part travailler dans une école maternelle. Là, un nouvel apprentissage : la patience, la tendresse. « Je m’occupais d’un petit garçon, Adam, qui n’avait pas encore son statut d’enfant handicapé. Il avait une sensibilité magnifique. Il reliait les flaques d’eau entre elles avec ses doigts. » Ce souvenir, doux et lumineux, revient souvent. Les enfants lui parlent, lui donnent une place. Elle a les cheveux roses, les petites filles lui demandent si elle est une princesse.
Mais les nuits restent brûlées. Les fêtes, la musique, les amours violentes. Avec Quentin, elle crée son premier groupe : Courtney Lol, clin d’œil à Courtney Love. « On rentrait de soirée, un mec m’a dit : “Eh, Courtney Lol, t’aurais pas une cigarette ?” C’est resté. » Quentin est le premier grand amour, chaotique et incandescent. « C’était très dur, beaucoup de violence, beaucoup d’amour aussi. » Elle reste, repart, revient. « Je considère que quand j’ai été amoureuse d’une personne, je le suis à vie. » Après lui, il y a Louis : même intensité, même vertige. « On vivait en squat. Et puis, après notre rupture, j’ai été hospitalisée sous contrainte. »
La fuite et la dérive
Première hospitalisation, premier face-à-face avec la psychiatrie. « J’en voulais énormément à ma mère. Je disais que je ne lui parlerais plus jamais. » Ça n’a pas duré longtemps. Car derrière la décision, il y avait la peur d’une mère pour la vie de sa fille. Luce a perdu du poids, se met en danger, ne distingue plus les frontières du réel. L’hôpital devient un lieu d’apprentissage.
Au début, elle refuse tout, attend le juge des libertés qui doit statuer sur sa sortie. Quand la décision tombe — non apte à reprendre une vie en société — elle bascule : « J’ai arrêté de faire ma connasse de Parisienne hautaine et jugeante. » Alors, elle s’intègre. Nettoie la cour, organise une règle de vie commune : un mégot jeté, trois mégots ramassés. Rédige des pancartes : « N’est-il pas plus agréable d’évoluer dans un environnement sain et exempt de mégots et autres déchets ? Merci pour cela d’utiliser ce que l’on appelle en français “corps”, doté d’articulations et de cerveau. Et croyez-moi, en combinant les deux, on fait des merveilles. » Et puis, le hasard encore : un infirmier de retour de vacances lui raconte qu’une femme, autrefois, avait fait la même chose qu’elle. Sa mère. Toutes deux hospitalisées dans le même établissement, à des époques différentes. « On se ressemble. »
De cette période naît une autre forme de regard. Elle découvre la psychothérapie institutionnelle, l’humain derrière la pathologie. À la clinique de La Borde, plus tard dans sa jeune vie, elle apprendra à lire les signes : un sourire, un geste, un regard. « Parfois les liens sont impalpables. » Elle cite Francis, un patient : « Tu vas partir ? Parce que je commence à bien t’aimer. » Cette phrase-là, pleine de pudeur et d’humour, reste pour elle une leçon de grâce. « Je crois beaucoup à ce qu’on appelle la pair-aidance, explique-t-elle : avoir traversé quelque chose te rend plus apte à aider ceux qui le traversent. » Déjà, sa vie devient matière à transmission.
La mer, le vent, la reconstruction
À la suite des hôpitaux, il y a la mer. Une mer immense, réconciliatrice, qui lave les blessures sans rien effacer. Luce embarque sur le Rara Avis, un voilier de trente mètres parti pour deux mois et demi de traversée atlantique. Le projet, imaginé par le père Jaouen, mêle navigation et reconstruction. « Le père Jaouen pensait qu’il fallait sortir de son milieu d’origine pour ne pas replonger, raconte Luce. Alors il les a embarqués sur un bateau. »
En janvier 2020, elle monte à bord. Ils sont trente-six. « Ça a été un voyage fantastique. Le début de la prise de conscience que je voulais changer, que je ne voulais plus rester dans ce schéma répétitif et qu’il fallait que je quitte Paris. » Les escales s’enchaînent : Bretagne, Espagne, Canaries, Cap-Vert. Puis le vent se dérègle, à l’image de son humeur. Hypomanie. Elle redescend avant la grande traversée, consciente du danger. « Étant diagnostiquée borderline, c’était risqué pour moi, mais aussi pour le reste de l’équipage. » Le choix de rentrer, déjà, est une victoire.
Avec sa mère, elle cherche une voie nouvelle : un retour à la terre. Dans la Drôme, elle trouve une ferme où elle fait du maraîchage bio. « C’était fantastique. Et deux jours plus tard, c’était le Covid. Heureusement que je ne l’ai pas passé à Paris. » Là où d’autres vivent l’enfermement, elle goûte la liberté. Les champs, les légumes, la nature lui redonnent une respiration. De mars à juillet, elle travaille, se reconstruit, respire. Mais la route n’est jamais droite. L’automne la mène à Bordeaux, où elle rêve d’une alternance en paysagisme. Là encore, le décor change, les démons non.
« Mes vieux démons m’ont vite reprise. Je suis arrivée dans un squat. » Un homme dans une piscine gonflable, des lunettes de soleil, un sourire sûr de lui. Jordan. L’attirance, immédiate. La chute, rapide. Ce qui suit, elle le raconte avec calme, tant la distance de la conscience recouvre désormais la douleur. Le crack, la manche, la rue. Et une découverte. « Les gens de la rue ont des chiens. Je me suis rendu compte que je me sentais mieux avec les chiens qu’avec les gens. » Un jour, chez des gitans où ils vont acheter de la cocaïne, un chiot maltraité se glisse entre ses jambes. « J’ai dit : vous gardez l’argent, mais on ne part pas sans le chien. » Elle l’appelle Osmose. Le nom dit tout.
Mais l’histoire s’enfonce. Jordan pousse Romain, un autre compagnon d’errance, à se prostituer. Puis vient la violence, l’inimaginable : coups, séquestration, police impuissante, cris derrière une porte close. « Je savais que ça pouvait très mal tourner. » Romain survit de justesse. Jordan part en prison. Luce, avec son chien dans les bras, appelle la police, puis sa mère. « J’étais dans un parking à Mulhouse, toutes mes affaires étaient sous scellé, Romain entre la vie et la mort et Jordan promis à la prison. J’ai pensé au suicide. Je pense vraiment qu’Osmose m’a sauvée. Il y avait Osmose. Je ne pouvais pas lui faire ça. »
Alors elle fait du stop, affronte encore la brutalité du monde, mais finit par rejoindre sa mère et un ami. Elle a vingt-trois ans. Tout pourrait s’arrêter là — mais c’est là, justement, que tout recommence.
La Borde, la lumière
Après Mulhouse, il faut tout reprendre. Pas de revenus, pas de logement, mais un chien, et surtout cette lucidité intacte. Sa mère trouve quelqu’un pour garder Osmose : une amie passionnée d’animaux, chez qui le chiot s’épanouit. Alors Luce peut partir en cure. « Je n’avais rien d’autre que mon cerveau, mes poèmes et mes parents. » La phrase résume cette conscience du privilège mêlé à la fragilité.
À Béziers, au CAARUD, elle avait rencontré Daniel, un travailleur social pas comme les autres. Normalement « chargé de paperasse », il devient un véritable appui humain. « Il était dans l’écoute, la compréhension. Je lui ai récité mes poèmes. Il trouvait ça fantastique. C’est lui qui m’a poussée à me revendiquer poétesse. » Elle expose ses collages et ses poèmes là-bas, un an plus tard. Peu de visiteurs, mais un livre d’or bouleversant. « Il y avait beaucoup de toxicos, mais les retours étaient très beaux. »
Luce connaît ses textes par cœur. Elle déclame dans la rue, fait la manche en marchant, non pas immobile mais vivante. « Je demandais : “Est-ce que vous êtes touchés par l’art ?” Quand on me répondait non, je demandais : “Ah bon, vous n’êtes pas touchés par l’émotion ?” » Des phrases simples, mais d’une vérité tranchante. Elle rit : « Certains me disaient : “Mais vous êtes si belle, comment ça se fait que vous êtes à la rue ?” Et j’avais envie de répondre : “Tu veux que je fasse quoi, que je me prostitue ? Tu crois que la beauté, ça sauve ?” »

L’art comme cicatrice
La poésie s’affirme, la broderie revient. « Ma grand-mère m’a appris, j’ai longtemps brodé pour mes amis. » Puis elle commence à vendre. Sur les tissus, elle brode des mots, des fragments. Comme une résistance, une manière de graver la grâce – comme elle dit. « Graver la grâce, c’est figer un instant. Ce n’est pas toujours avec des mots. Parfois, c’est tissé. Parfois, c’est une photo ou un collage. » Dans ses images, on ne distingue pas toujours ce qui est photo ou dessin, fragment ou transparence : « C’est à toi de voir dans quel sens tu le mets. »

La poésie est partout, mais jamais enfermée dans le drame. Écrire, pour Luce, c’est à la fois se réparer et transmettre. « Ça me permet de mettre des mots sur mes émotions, de rendre belles certaines choses très dures, en les transformant en art. Et puis certaines choses sont trop difficiles à raconter autrement. » Dans l’écriture, elle trouve un exutoire, mais aussi une vérité nue, sans fard ni posture.

Le corps, la mémoire, la révolte
Un soir, lors d’une fête, la violence revient frapper, sans prévenir. Une lampe, un geste, une erreur. « Karel voulait frapper mon copain Anthony, mais c’est moi qui ai pris le coup. » Coma, urgence, visage tuméfié, une dent en moins. « Ce n’était pas la première fois que des médecins me disaient : “Vous avez de la chance d’être encore en vie.” » Cette fois, elle porte plainte — pour la première fois. « Avant, je n’avais jamais porté plainte. Là, les flics ne pouvaient pas me dire : “Vous portiez une jupe ?” » Elle rit, doucement, d’un rire qui désamorce la tragédie.
De cette période sombre, elle tire la volonté de s’éloigner. Quitter Paris, adopter un nouveau chien – Gingka –, reconstruire un foyer ailleurs. Dans le Sud-Ouest, elle trouve un village, Souillac, où elle s’installe. « Je ne voulais pas que Gingka grandisse à Paris. »
Elle vit, aime, rompt encore. Reviennent la fatigue, les excès, l’alcool, la solitude. « Je buvais, je prenais beaucoup de coke, seule, très isolée. » Mais la conscience, encore, veille. Elle entre à la clinique de La Chesnaie : quatre mois et demi de sevrage, de reprise, d’écriture, de soins.
La rencontre et la renaissance
Lors d’une sortie d’une semaine — Gingka devait être stérilisée —, elle prend un Airbnb à Blois. Elle cherche un endroit vivant. On lui parle de Les Temps d’Arts. Elle appelle. Au téléphone, un homme : Trich. « Il m’a dit : “Non, on est un ERP, on ne peut pas ouvrir, on ne fait pas d’événements…” » Alors elle répond : « Et demain ? » Ils rient. Quinze minutes de conversation, de connivence. Il lui propose un verre au M. Elle y va. Deux cents personnes, un samedi soir. Parmi la foule, elle le reconnaît. « C’est toi, Trich ? » C’était lui.
De là naîtront l’amour, le groupe électro-pop Pagaille et son Kir Cassis, les nouvelles amitiés, les poèmes partagés sur scène. Luce trouve sa place à Blois, une communauté. Ses collages et ses textes circulent, ses broderies deviennent des messages cousus main, ses mots s’ancrent dans le tissu du réel.
Luce, la lumière
Aujourd’hui, elle parle de son parcours sans détour, mais avec douceur. Elle ne veut pas d’un récit tragique. « J’ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, dit-elle. Quand j’étais à la rue, beaucoup de gens m’ont payé des nuits d’hôtel, m’ont donné de l’argent, ou m’ont aidée simplement en prenant le temps de parler avec moi. Et puis j’ai eu la chance d’avoir mes parents, ma sœur, mes amis, qui ont toujours tenté de m’aider du mieux qu’ils ont pu. »
Le portrait qu’elle souhaite donner, c’est celui de la gratitude. Elle vit aujourd’hui entre Blois et la campagne, entourée de forêts et de champs, de silence, et de Gingka. « Souvent, les humains parlent pour ne rien dire. Les chiens, eux, sont purs, et apportent un amour inconditionnel. »
Elle parle d’intensité, de liberté, de l’envie d’être « autonome sans être isolée ». Elle écrit, brode, photographie, compose. Son nouveau recueil de poèmes est quasiment prêt.
Son rire, parfois grave, se mêle à la lucidité. Elle dit : « Je veux juste réussir à me maintenir en bonne santé physique et psychique sur la durée. Pour le reste, on verra. » À 29 ans à peine, Luce a déjà vécu cent vies, mais refuse qu’on les réduise à la souffrance. Et dans sa voix, il y a la lumière de celles qui ont traversé le feu sans se laisser consumer. « J’ai souvent eu de la chance dans mon malheur.
C’est peut-être pourquoi j’ai tant joué avec le feu.
Sûrement, je suis incombustible. »
Luce Lefebvre-Goldmann vit aujourd’hui entre Blois et la campagne. Poétesse, collagiste, brodeuse et photographe argentique, elle mêle les arts comme on tisse la mémoire, la grâce et la survie. Ses créations sont en vente à la boutique & Lieu de vie Blois Capitale, 16 rue Emile Laurens.