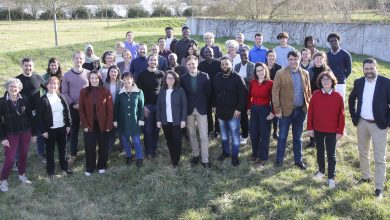La construction du pont Jacques Gabriel en peinture

La construction du pont Jacques Gabriel, à Blois, est une grande réalisation architecturale du XVIIIᵉ siècle. À la fois infrastructure essentielle et symbole d’un savoir-faire, il a traversé trois siècles et les épreuves historiques pour devenir un monument emblématique ligérien.
Une catastrophe marquante
En février 1716, le pont médiéval de Blois s’effondra sous l’effet des crues violentes et du gel prolongé. En deux jours, les treize arches reliant la ville et le faubourg de Vienne furent emportées, privant Blois de toute liaison directe entre les deux rives de la Loire. Ce drame marqua profondément les contemporains. Face à cette situation, le régent Philippe d’Orléans intervint rapidement. Le 14 novembre 1716, il accorda l’autorisation de construire un nouveau pont. Jacques Gabriel, architecte et premier ingénieur des Ponts et Chaussées, fut désigné pour diriger ce chantier complexe. L’équipe inclut également des ingénieurs de renom tels que Jean-Baptiste de Règemorte et Robert Pitrou, spécialistes des infrastructures fluviales.
Une construction d’envergure
Les travaux débutèrent en avril 1717. Le pont, conçu dans une architecture en dos d’âne, mesure 302 mètres de long pour 15 mètres de large. Il repose sur onze arches en anse de panier, dont l’arche centrale, plus large et plus haute, est soulignée par une pyramide ornementale. Cette dernière, conçue par le sculpteur Guillaume Coustou, symbolise la grandeur de l’ouvrage.
La construction fut ralentie par plusieurs défis. Les deux premières piles, situées côté ville, nécessitèrent la construction d’un quai pour stabiliser les fondations. Les techniques employées, notamment l’utilisation de pieux en bois préalablement brûlés pour faciliter leur enfoncement, témoignent de l’ingéniosité des bâtisseurs. Ces pieux étaient enfoncés dans le sol grâce à un « mouton », un appareil manœuvré par plusieurs dizaines d’ouvriers.
En 1718, les travaux avancèrent sur les piles et les trois premières arches, tandis que le quai de la rive droite fut prolongé. Les pierres utilisées provenaient des carrières voisines de La Chaussée-Saint-Victor, renommées pour leur calcaire dur et résistant. Les arches furent achevées en 1722, et le pavage final et les ornements furent terminés en 1724. Le pont fut officiellement ouvert à la circulation le 4 mai 1724.

Une documentation visuelle précieuse
L’importance du chantier de construction est illustrée par une toile, intitulée Vue de Blois avec le pont en construction. Réalisée vers 1718, cette œuvre est attribuée (même si un doute persiste) à Jean-Baptiste Martin, dit «l’Aîné» ou «le Jeune». Conservée au Museo Franz Mayer à Mexico, elle offre une représentation des techniques et des conditions de travail de l’époque.
La peinture montre le chantier en activité : les ouvriers procèdent au dragage de l’eau à l’aide de roues manuelles ou tirées par des chevaux, tandis que d’autres installent les pieux sur les fondations. En arrière-plan, les maçons érigent les maçonneries. Un groupe de nobles observe les travaux depuis l’angle inférieur droit de la toile, soulignant le caractère prestigieux de cette entreprise.
Des épreuves au fil des siècles
Le pont Jacques Gabriel subit de nombreuses atteintes au cours de son histoire. Pendant la Révolution française, la plaque de marbre commémorative fut détruite. En 1793, deux arches furent détruites pour retarder l’avance des troupes vendéennes. En 1870, des réparations furent nécessaires après la guerre franco-prussienne.
La Seconde Guerre mondiale marqua une nouvelle épreuve : en juin 1940, l’armée française fit sauter une arche pour ralentir l’avancée allemande. En 1944, trois arches centrales furent détruites par les Allemands en retraite. Après la Libération, une passerelle provisoire fut installée pour rétablir la circulation, suivie d’une reconstruction à l’identique entre 1945 et 1948.

Classé Monument Historique depuis 1937, le pont Jacques Gabriel incarne le patrimoine et la résilience de Blois. Sa silhouette en dos d’âne, mise en valeur par la pyramide centrale et les cartouches sculptés, demeure un symbole de l’élégance architecturale. Les efforts de reconstruction après-guerre symbolisent une volonté de préserver cet héritage pour les générations futures.