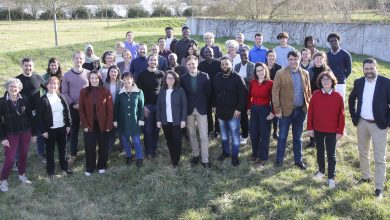Avec plus d’un million de signatures recueillies en quelques jours, la pétition contre la loi Duplomb établit un précédent historique sous la Ve République. Mais cette mobilisation populaire peut-elle réellement faire tomber une loi ?
Le chiffre impressionne, le compteur tourne à vive allure. Ce dimanche 20 juillet à 17h50, plus d’un million de personnes ont apposé leur signature sur la pétition déposée sur le site officiel de l’Assemblée nationale pour demander l’abrogation de la loi Duplomb, texte autorisant notamment la réintroduction du pesticide acétamipride, un néonicotinoïde très contesté. Lancée le 10 juillet, deux jours après l’adoption du texte porté par le sénateur LR Laurent Duplomb, l’initiative numérique a largement franchi le seuil symbolique des 500 000 signatures, fixé par la réforme de 2020 comme condition pour déclencher un débat parlementaire.
C’est une première dans l’histoire institutionnelle française. Jusqu’à présent, jamais une pétition citoyenne n’avait obtenu un tel écho. Le précédent record remontait à 2023, avec la demande de dissolution de la BRAV-M, restée lettre morte malgré ses 264 000 soutiens.
Une procédure encadrée, mais sans pouvoir contraignant
La réforme constitutionnelle de 2020, mise en œuvre via la plateforme de pétitions de l’Assemblée nationale, prévoit qu’une initiative citoyenne dépassant 500 000 signatures — à condition qu’elles soient réparties dans au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer — peut être soumise à la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale. C’est à cette instance, réunissant les présidents des commissions permanentes, les présidents des groupes parlementaires et le président de l’Assemblée, qu’il revient de décider de l’inscription à l’ordre du jour d’un débat.
Mais attention aux illusions : l’inscription à l’agenda de l’Assemblée ne signifie pas que le texte de loi concerné fera l’objet d’un réexamen, encore moins d’un vote ou d’un abrogation automatique. Le débat potentiel portera uniquement sur la pétition elle-même, et aucune décision législative contraignante n’en découlera.
L’abrogation, un processus politique autonome
Pour qu’une loi soit réellement abrogée, deux voies juridiques existent :
- L’adoption d’une nouvelle loi, dite de dérogation, qui vient explicitement supprimer ou modifier le texte en vigueur. Cette procédure suppose qu’un parlementaire ou le gouvernement dépose une proposition ou un projet de loi, suivi d’un vote favorable dans les deux chambres.
- Le refus de promulgation par le président de la République, qui, en théorie, peut choisir de ne jamais signer une loi votée, empêchant ainsi son entrée en vigueur. Cette option demeure extrêmement rare et politiquement risquée, car elle pourrait être interprétée comme un déni du vote parlementaire.
Dans le cas présent, la loi Duplomb a déjà été adoptée, ce qui signifie que seule une initiative parlementaire ultérieure — et acceptée par les majorités en place — pourrait revenir sur ses dispositions.
Un signal politique inédit
Malgré ses limites juridiques, cette mobilisation citoyenne n’en est pas moins hautement symbolique. Elle marque une montée en puissance de la démocratie participative dans un pays où les mécanismes d’expression directe des citoyens sont historiquement restreints. L’écho rencontré par cette pétition pourrait ainsi inciter des groupes parlementaires à relayer la demande dans l’hémicycle sous forme de proposition de loi, ou au minimum à en faire un thème central du débat politique.
En outre, le fait que cette pétition déclenche potentiellement un débat public à l’Assemblée constitue un précédent institutionnel. Ce serait la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’un tel mécanisme déboucherait sur une discussion en séance plénière.
Une victoire d’étape, pas encore une victoire législative
En somme, si la pétition contre la loi Duplomb ne peut pas, à elle seule, provoquer son abrogation, elle ouvre cependant une fenêtre politique et médiatique pour relancer le débat. La balle est désormais dans le camp de la Conférence des présidents, puis des parlementaires, qui seuls peuvent faire évoluer le droit. La loi Duplomb n’a peut-être pas encore fini de faire parler d’elle.
Pour preuve, vendredi à Blois, une trentaine d’agriculteurs de la Coordination rurale 41 ont manifesté à Blois devant la permanence régionale d’EELV, en réaction aux propos de la députée écologiste Sandrine Rousseau qualifiant la rentabilité agricole par les pesticides d’« argent sale ».