Fallait-il opérer le cerveau de Maurice Ravel ?

Il y a quatre-vingt-six ans, le célèbre musicien Maurice Ravel nous quittait, victime d’une maladie dégénérative du cerveau qui pendant longtemps a été difficile à catégoriser. L’étude menée par les Professeurs Théophile Alajouanine et Henri Baruk en 1936, publiée douze ans plus tard, reste une référence concernant cette maladie.
Apparue chez Ravel vers 45 ans, cette affection se traduisait par des problèmes d’écriture, évoluant vers une agraphie (perte de la capacité d’écrire) complète associée à une alexie (trouble de la lecture). Il présentait également des déficits dans la coordination gestuelle, une forme d’apraxie (incapacité d’exécuter des mouvements intentionnels précédemment appris), ainsi qu’une légère aphasie (trouble de la communication). Cependant, ni sa cognition globale ni ses capacités musicales n’étaient gravement affectées.
Le professeur Alajouanine a suggéré que cette maladie se rapprochait de la maladie de Pick, sans toutefois être identique. Aujourd’hui, on la perçoit possiblement comme une forme spécifique d’atrophie cérébrale dégénérative (bulletin de l’académie de médecine de 2017).
Fallait-il opérer le cerveau de Maurice Ravel ?
Selon le professeur Théophile Alajouanine (1890-1980), neurologue à la Salpêtrière, qui, avec son collègue psychiatre Henri Baruk (1897-1999), a suivi le compositeur de génie pendant deux ans, la réponse était donc non. Bernard Lechevalier (94 ans), neurologue ayant été interne auprès du professeur Alajouanine, l’a répété à plusieurs reprises, dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire à Blois, encore atterré de cette décision qui allait conduire à la mort de Maurice Ravel le 28 décembre 1937, quelques jours après l’intervention.
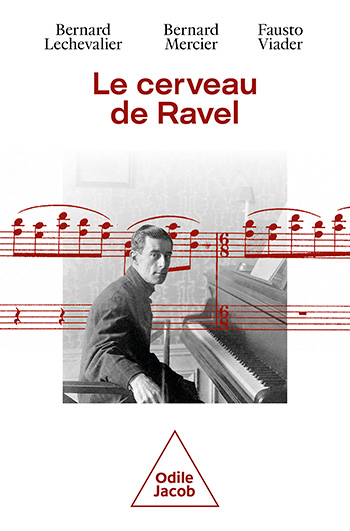
Mais reprenons le fil de cette table ronde à plusieurs voix, animée par Bernard Mercier, médecin gériatre au Centre Hospitalier de Blois et auteur d’une thèse qualifiée de chef d’œuvre par Bernard Lechevalier sur la maladie neurologique dégénérative de Maurice Ravel. Aux deux neurologues s’ajoutent Fausto Viader, également neurologue, et Manuel Cornejo, président de l’association des amis de Maurice Ravel. Bref, les quatre spécialistes qui ont rédigé préface et texte du livre « Le cerveau de Ravel » (éditions Odile Jacob, 340 pages, 23.90€) étaient présents.
Retour sur la vie et la mort de Maurice Ravel
Le célèbre compositeur naît à Ciboure, près de Saint-Jean-de-Luz, en mars 1875. À grands traits, Bernard Mercier décrit une enfance heureuse avec des parents musiciens qui le conduisent naturellement vers le conservatoire de Paris où il étudie le piano et la composition. La première guerre mondiale marque un tournant dans la vie de Maurice Ravel. Bien que frêle et de petite taille (il s’est vu opposer un refus par l’armée), l’homme souhaite absolument faire œuvre de patriotisme. Il conduira un camion à l’arrière front pour ramasser les corps vivants ou morts. Expérience terrible pour Maurice Ravel qui écrit tous les jours, voire plusieurs fois par jour, à sa chère mère ou encore à sa marraine de guerre. À la fin du conflit, lorsqu’il rentre à Paris, sa mère meurt dans ses bras. S’ensuit une profonde dépression pour Maurice Ravel.
Dès 1921, il s’installe à Montfort-l’Amaury, dans l’ouest parisien, recherchant à la fois le calme pour composer en paix et la proximité de Paris. Maurice Ravel, solitaire et éternel célibataire, garde le mystère sur sa vie amoureuse, s’il en eut une. Ce fut alors la montée vers la gloire, des tournées en Europe et aux États-Unis dont il rentre fatigué.
En 1931, il écrit le concerto pour la main gauche, son chef d’œuvre absolu selon Bernard Lechevalier. Mais déjà Maurice Ravel souffre de troubles du geste. Sa correspondance le met en évidence avec des ratures qui apparaissent, des mots oubliés. Ses troubles sont tels, qu’il ne peut plus écrire la musique qu’il continue pourtant de composer dans sa tête. Cela se traduit par une immense souffrance selon Bernard Mercier. Il consulte alors les professeurs Alajouanine et Baruck à la Salpêtrière qui entament une phase de recherche et d’analyse. Il paraît alors difficile de faire la part entre ce qui pourrait relever d’un surmenage et d’une maladie.
Les examens deviennent plus invasifs, Maurice Ravel subit une encéphalographie gazeuse dont la description fait frémir l’assemblée réunie ce dimanche matin dans la salle Gaston d’Orléans du Château de Blois : après avoir retiré par une ponction lombaire le liquide céphalo-rachidien, de l’air était envoyé dans la moelle épinière du patient qui servait de contraste en moulant les structures nerveuses, pour voir leur morphologie extérieure. Procédé extrêmement douloureux, heureusement depuis longtemps remplacé par le scanner notamment. Mais cet examen permet de poser le diagnostic d’une atrophie cérébrale.
La situation se dégrade, la maladie s’avère dégénérative. Suite à un accident de taxi qu’il a eu en 1932, Maurice Ravel cesse définitivement de composer. La famille de Ravel souhaite alors, que même si les chances de succès sont infimes, une opération sur le cerveau soit réalisée. Clovis Vincent, neurochirurgien, tente le tout pour le tout le 27 décembre 1937, avec une opération à cerveau ouvert, réalisée sans anesthésie, dont Maurice Ravel ne se relèvera pas. Et Bernard Mercier de préciser que Clovis Vincent fut un grand neurochirurgien dont les compétences ne peuvent être mises en cause.
Quant à la source de cette maladie dégénérative, le mystère demeure. Bernard Mercier n’exclut pas que le choc post-traumatique que Ravel a subi lors de la première guerre mondiale ait entraîné une lésion cérébrale.
Quoi qu’il en soit, Maurice Ravel est bien mort, mais sa musique restera toujours vivante. Le Bolero est le morceau le plus donné dans le monde toute catégorie, et le concerto en sol majeur (son unique concerto) est le plus joué au monde.







