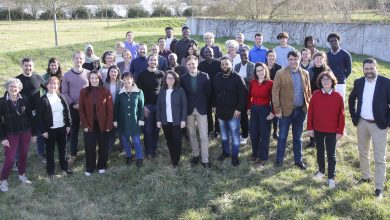De Blois à Haïti, le combat universel de l’abbé Grégoire

Né en 1750 dans une famille modeste de Vého, en Lorraine, Henri Jean-Baptiste Grégoire, connu sous le nom de l’Abbé Grégoire, fut évêque constitutionnel de Blois. L’homme s’imposa comme une voix singulière de la Révolution française, un ardent défenseur des droits de l’homme et un pionnier du combat contre l’esclavage, l’antisémitisme et le racisme scientifique.
De la chaire d’Emberménil à l’Assemblée nationale
Ordonné prêtre en 1776, Grégoire exerce à Emberménil à partir de 1782. Il y lit les philosophes des Lumières, dont il cherche à réconcilier les idées avec la foi chrétienne. En mai 1789, il est élu député du clergé aux États généraux, et prend rapidement position en faveur de la fusion des ordres et de l’égalité des droits civiques. Il rallie le Tiers État lorsque celui-ci se proclame Assemblée nationale. Il est président de séance le 14 juillet 1789, jour de la prise de la Bastille.
Bien qu’il soit souvent présenté à tort comme l’auteur de l’article premier de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, adopté fin août 1789 (« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »), il n’en est pas le rédacteur. Il participe néanmoins activement aux débats, aux côtés de Mirabeau, Sieyès et La Fayette, et en partage les idéaux fondamentaux.

Évêque constitutionnel de Blois
En février 1791, Grégoire est élu évêque constitutionnel de Blois, à la suite de la réorganisation ecclésiastique de la France décidée par la Constitution civile du clergé. Il prête serment à la nouvelle Église constitutionnelle, qu’il ne reniera jamais. Sa devise : « Je suis comme le granit, on peut me briser, on ne me plie pas ».
À Blois, il devient un homme de terrain autant qu’un symbole. Il prononce des sermons républicains, défend la laïcisation des institutions et la tolérance religieuse, tout en restant fidèle à une lecture chrétienne du message évangélique. Il est l’un des artisans du décret du 27 septembre 1791, qui reconnaît enfin la citoyenneté aux Juifs de France, auparavant exclus des droits civiques. Son Essai sur la régénération des Juifs (1788) a préparé le terrain intellectuel de cette réforme majeure.
Une voix abolitionniste au cœur de la Révolution
Dès décembre 1789, il adresse à l’Assemblée son Mémoire en faveur des gens de couleur ou sang-mêlé de Saint-Domingue, plaidoyer pour l’égalité civique des libres de couleur dans les colonies. Il rejoint peu après la Société des Amis des Noirs, fondée par Brissot, où il devient un membre influent. En 1793, il obtient la suppression des primes accordées aux armateurs négriers, mécanisme qui subventionnait indirectement la traite.
Membre de la Convention nationale, il joue un rôle actif dans l’abolition de l’esclavage proclamée le 4 février 1794 (16 pluviôse an II). Selon l’historien Bernard Gainot, c’est Grégoire qui a imposé l’emploi du mot « esclavage » dans le décret, pour empêcher toute tentative de réinterprétation. Il ne cessera, dès lors, de défendre ce texte contre ses détracteurs, et s’engage aux côtés de Toussaint Louverture, avec qui il échange des lettres sous le Directoire.
De la tribune révolutionnaire au combat isolé
Nommé sénateur en 1801, dans le cadre du Concordat, il reste opposé à Napoléon Bonaparte, qu’il qualifie de « despote incorrigible ». Il est le seul sénateur connu à voter contre le rétablissement de l’esclavage en 1802. C’est dans cette période d’isolement croissant qu’il publie, en 1808, son ouvrage le plus célèbre : De la littérature des nègres ou Recherches sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature.
Véritable manifeste abolitionniste, ce livre s’attaque à la rhétorique raciste du temps. Il dresse la liste de 271 personnalités (hommes, femmes, Noirs, Blancs) ayant défendu l’égalité, cite des auteurs africains et antillais, et démontre, contre les théories racialistes en vogue, l’unité de l’espèce humaine. Il y affirme : « Les Nègres étant de même nature que les Blancs, ont donc avec eux les mêmes droits à exercer, les mêmes devoirs à remplir. » L’ouvrage est salué à l’étranger, notamment en Haïti, où le roi Henri Ier commande 50 exemplaires, mais violemment attaqué en France par les colons, notamment dans Le Cri des colons (1810).
L’hommage discret d’une République ingrate
Grégoire meurt le 28 mai 1831, ignoré par l’Église officielle comme par les autorités monarchiques, mais suivi dans la rue par des milliers de Parisiens. Il est inhumé sans cérémonie religieuse. En 1989, à l’occasion du Bicentenaire de la Révolution française, ses cendres sont transférées au Panthéon, aux côtés de Condorcet, autre figure du combat pour les droits universels. L’Église catholique, toujours réticente à reconnaître son rôle dans la Révolution, refuse d’y être représentée.

Aujourd’hui, un buste abimé le représentant trône à Blois, dans le jardin en friche de l’ancien hôtel-Dieu en travaux. Sculpté par Alfred Halou en 1886 d’après un modèle de David d’Angers, il est inscrit au patrimoine public.
Une figure à redécouvrir
Henri Grégoire fut sans doute l’un des rares hommes de son temps à défendre l’universalité des droits sans restriction de race, de religion ou de naissance. Il est aujourd’hui reconnu comme un prédécesseur de Victor Schœlcher, de W.E.B. Du Bois ou de Léopold Sédar Senghor, qui disait de lui : « L’abbé Grégoire a, le premier, réhabilité le Noir ».