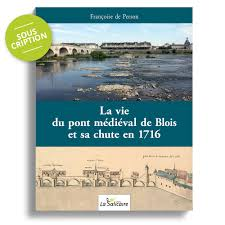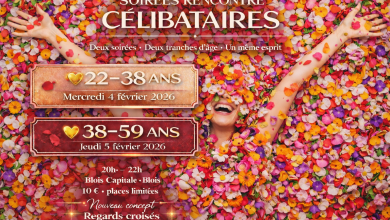Françoise de Person : le pont médiéval de Blois, une mémoire retrouvée

À peine le soupçonne-t-on sous les remous de la Loire. Les pierres affleurent, les ruines émergent, et déjà se dessine la structure engloutie d’un pont. C’est bien là, encore aujourd’hui, la trace du pont médiéval de Blois. Françoise de Person, historienne, a choisi d’en restituer l’histoire dans un livre dense, fruit de plusieurs décennies de recherche : « La Vie du pont médiéval de Blois et sa chute en 1716 » (éditions La Salicaire, 24,00€), préfacé par Christophe Degruelle, président d’Agglopolys.
Le parcours de Françoise de Person est marqué par une fidélité constante à la Loire. Sa thèse, soutenue à l’université de Tours en 1989, portait déjà sur Les voituriers par eau et le commerce sur la Loire à Blois au XVIIe siècle*. Chercheuse et éditrice, Françoise de Person s’est donné pour objectif de partager ses travaux avec le plus grand nombre. Elle revendique cette volonté de diffusion : « Mon objectif, c’est de communiquer mes recherches. »
Le choix du pont médiéval
Habiter Blois et Molineuf, étudier depuis longtemps la Loire et sa navigation, entendre circuler approximations et erreurs : autant de raisons qui l’ont conduite à se tourner vers le pont médiéval. « J’entends aussi beaucoup de bêtises sur les ports de Blois… Je n’avais jamais publié sur Blois. Je me suis dit : je fais un livre. Le sujet du pont médiéval m’a semblé un beau sujet. » L’historienne insiste sur l’importance de sa période de prédilection, le XVIIe siècle, trop souvent négligé. C’est à cette époque qu’elle a choisi de situer son récit. « D’abord, c’est ma période. Elle n’est pas valorisée. »
Mais, revenons sur le pont et la violence de son effondrement. Le 7 février 1716, treize arches du pont médiéval cèdent sous la pression des glaces et s’écroulent. Maisons, moulins, chapelle disparaissent dans les flots. Seules sept arches, côté faubourg de Vienne, subsistent. Le pont, qui avait résisté plus de six siècles, n’est plus. « Les habitants devaient être sidérés ». Cette disparition emporte avec elle l’activité du pont : communications rompues entre provinces du Nord et du Sud, disparition des échanges, du rôle religieux, industriel et commercial.

Une rue animée
Dans un chapitre intitulé « L’animation d’une rue », Françoise de Person décrit le pont comme un véritable quartier. « Le pont n’est pas uniquement une voie de passage. Il constitue un quartier à part, sur l’eau, avec ses industries, ses commerces, la chapelle Saint-Fiacre. » Rois, reines, princes l’ont emprunté : Gaston d’Orléans, Louis XIV, le duc d’Anjou, Jean de La Fontaine. Mais aussi des voyageurs anonymes, des pèlerins, des charretiers, des Blésoises et des Blésois, des badauds, des voleurs, des mariniers, des cordiers. On y travaillait, on y vivait.
La circulation y était pourtant difficile. Large de huit mètres seulement, pavée mais étroite, la chaussée était sans cesse encombrée. « Les embarras », disait Boileau. Chocs continuels, pavés disjoints, parapets à réparer, bouteroues à remettre. Les échevins, accompagnés des maîtres paveurs, inspectaient régulièrement les lieux pour dresser devis et réparations.
Les sources notariales
Le travail de Françoise de Person repose sur un corpus de sources rarement exploitées : les minutes notariales. « C’est très riche », souligne-t-elle. « On allait tout le temps chez notaire : on se bagarrait, on finissait par un accord, il y a les marchés de transport, les naufrages. Toute la vie est là. » Ces documents permettent de croiser les informations, de suivre les réparations, de repérer les incidents. En recoupant avec les registres municipaux et les plans d’ingénieurs comme Nicolas Poictevin, l’historienne a pu reconstituer les usages du pont, jusqu’à ses effondrements partiels et à sa destruction finale.
Le livre n’est pas dépourvu d’anecdotes, qu’elle assume comme une « marque de fabrique ». Elle cite par exemple l’entrée de Philippe V d’Espagne, petit-fils de Louis XIV devenu roi d’Espagne, reçu à Blois avec ses frères. « Ils n’allaient pas en avion. Ils s’arrêtaient dans toutes les villes et ils étaient reçus avec les honneurs », raconte-t-elle. Mais elle revendique la rigueur historique : « Je m’arrête là où j’ai un document. Si le texte dit : j’ai failli me noyer, je n’ajoute pas qu’on lui a porté une couverture. Mes livres ne sont pas romancés. »
Un pont disparu, une ville transformée
La conclusion du livre replace la disparition du pont médiéval dans le long cours de l’histoire urbaine. « La chute du pont a été le point de départ d’un nouvel urbanisme », écrit Françoise de Person. Construction du pont Jacques-Gabriel, percée de Saint-Gervais (devenue avenue Wilson), aménagement de quais larges et rectilignes : en un siècle, le visage de Blois est métamorphosé.
Il reste quelques traces, à qui sait les regarder : piles visibles à l’étiage, toponymes anciens comme la « rue du Vieux Pont », disparue après 1940, mémoire des ports bouleversés. Le faubourg de Vienne, les rues de la Chaîne et des Chalands, autrefois baignées par la Loire, ont été radicalement transformées. Une mémoire urbaine s’est effacée avec le pont.
Réaliser un tel livre suppose un engagement financier considérable. « Les historiens n’ont aucun sou », constate-t-elle. « J’ai publié à mes frais. » Elle a tenu à ce que l’ouvrage soit illustré, en couleur, quand beaucoup de livres d’histoire demeurent austères. En choisissant le pont médiéval de Blois, Françoise de Person restitue un pan entier de la vie de la cité, souvent éclipsé par l’omniprésence du château et de la Renaissance. Elle comble un vide historiographique et redonne une mémoire à un monument disparu. Il s’agît donc là d’un livre important. « C’était un beau sujet », dit-elle simplement. « Et je suis contente du résultat. »
*De là, une série d’ouvrages a suivi : Bâteliers sur la Loire. La vie à bord des chalands (2017, nouvelle édition), Bâteliers contrebandiers du sel. La Loire au temps de la gabelle (2010), La Marine de Loire au XVIIe siècle (2006), Un Orléanais à la conduite de son négoce sur la Loire, par mer et par terre (2010), Les graffitis de bateaux de Chambord. Une invitation à la navigation (2011), ou encore Le Livre d’Estienne Sallé voiturier par eau et charpentier en bateaux (2022).