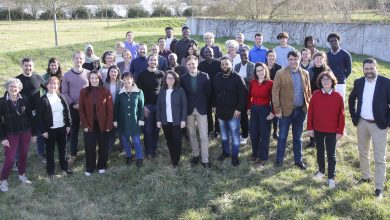Guillaume Marsallon : « La législation telle qu’elle est faite est très compliquée »

Mercredi, à l’occasion de la Journée internationale des migrants, la Ligue des Droits de l’Homme et le Collectif de soutien aux sans-papiers et demandeurs d’asile du Loir-et-Cher organisaient une table ronde à Blois, à l’Espace Jorge Semprún. L’objectif était d’aborder, sous différents angles, les questions liées aux droits et à l’accueil des personnes étrangères. Parmi les intervenants figuraient le collectif Pas d’Enfants à la Rue, la Cimade, l’UD CGT 41, l’ASMCV, ainsi que Maître Sandrine Cariou, avocate spécialisée dans le droit des étrangers.
Au sein de ce panel, l’intervention de Guillaume Marsallon, délégué à la Cimade, a permis de mettre en lumière le rôle central du droit au séjour pour toute réflexion autour de l’hébergement, du logement et de la lutte contre la précarité. « On ne peut pas réfléchir à la question de l’hébergement ou du logement sans réfléchir au droit au séjour », a-t-il martelé. Selon lui, « c’est prendre la question par ses conséquences et pas par ses causes » que de chercher des solutions d’hébergement sans s’attaquer en amont au problème de l’absence de titre de séjour. « Sinon, on va dans le mur », a-t-il insisté.
Une multitude de « petites cases » juridiques
Le délégué de la Cimade est ainsi revenu sur la difficulté, pour les personnes étrangères, d’entrer dans les « cases » du droit au séjour, soulignant que ce n’est pas le nombre de catégories juridiques qui pose problème, mais la rigidité des conditions pour y accéder. Cette complexité administrative fragilise d’autant plus les personnes étrangères, empêchant une stabilisation de leur situation.
Selon les données officielles du ministère de l’Intérieur pour l’année 2023, la France a délivré un total de 326 954 premiers titres de séjour. Ces documents, nécessaires pour résider légalement sur le territoire, ont été attribués pour des motifs divers. Parmi eux, 33 % ont été délivrés à des étudiants étrangers, représentant ainsi la catégorie la plus importante. En deuxième position, 28 % des titres ont été accordés pour des raisons liées à la vie privée et familiale, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.
Le droit d’asile, bien que crucial, a concerné une proportion plus restreinte, avec 11 % des premiers titres de séjour attribués en vertu de ce motif, soit environ 43 000 personnes. Par ailleurs, les motifs professionnels ont représenté 16 % des titres délivrés, mais cette catégorie recèle une réalité plus complexe. En effet, parmi les 54 000 titres accordés pour des raisons liées au travail, seuls 11 000 ont été obtenus dans le cadre d’une régularisation de travailleurs déjà présents sur le territoire. Ce chiffre, qui équivaut à environ 3 % du total des premiers titres de séjour, illustre la difficulté de ce processus, marqué par une législation particulièrement stricte. Enfin, les motifs de santé, bien qu’essentiels pour les personnes concernées, n’ont représenté qu’1 % des titres délivrés.
Ces chiffres mettent en lumière non seulement la diversité des situations juridiques des personnes étrangères, mais aussi les obstacles administratifs qu’elles doivent surmonter pour obtenir un titre de séjour. « La législation telle qu’elle est faite est très compliquée », a commenté le délégué de la Cimade, pour souligner les défis auxquels ces personnes sont confrontées dans leurs démarches.
Entre logement et hébergement : la question du titre de séjour en toile de fond
Le lien entre droit au séjour et conditions de vie se cristallise particulièrement sur la question du logement et de l’hébergement. « Le logement social nécessite absolument d’avoir un titre de séjour », a rappelé Guillaume Marsallon. Quant au logement privé, « ce n’est pas strictement interdit sans titre de séjour », mais dans les faits, sans garanties ni emprunts possibles, l’accès est quasiment bloqué. Le propriétaire exigeant des revenus réguliers, la situation administrative de la personne étrangère devient immédiatement un frein.
L’intervenant a poursuivi sur le thème de l’hébergement, insistant sur le fait de le décliner au pluriel, tant il existe une multitude de dispositifs. Certains sont exclusivement réservés aux demandeurs d’asile (CADA, UDA, PRADA, CPH, etc.), et donc inaccessibles aux autres personnes étrangères. Puis il y a l’hébergement d’urgence, défini par le Code de l’action sociale et des familles (le fameux article L.345-2-2), souvent appelé « la loi Molle » — un nom qui, note-t-il avec ironie, « n’était peut-être pas très inspiré ».
Cet article stipule que « toute personne » en situation de détresse a le droit d’accéder à un hébergement d’urgence. « Toute personne, ça veut dire avec titre, sans titre de séjour », a insisté Marsallon. Mais le Conseil d’État, confronté aux contentieux, a introduit la notion de « détresse » et de « vulnérabilité », un concept juridiquement difficile à définir. On assiste à une « stratification de la misère », regrette-t-il. Selon les jurisprudences, la vulnérabilité devient un critère interprété de plus en plus strictement, classant les situations sur une échelle du « très vulnérable » au « pas très vulnérable ». « Aujourd’hui sur l’hébergement on en est là, avec une foultitude de décisions qui sont le petit musée des horreurs », déplore-t-il, évoquant des cas où l’on considère qu’une mère avec des enfants de 14 ou 17 ans n’est pas suffisamment vulnérable.
L’autre difficulté provient de la répartition des compétences entre divers acteurs. Le Conseil d’État a désigné le Conseil départemental, via l’aide sociale à l’enfance, pour les mères isolées avec enfant de moins de trois ans, l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) pour les demandeurs d’asile, et l’État (via la préfecture) pour tous les autres cas. Là encore, la question du statut administratif est centrale pour savoir à qui s’adresser, et pour déterminer si l’aide est accessible ou non.
La création de centres de préparation au retour, nouvelle source d’inquiétude
Guillaume Marsallon a également évoqué l’apparition de dispositifs encore plus spécifiques, les CEPAR (anciennement DEPAR), que la Cimade perçoit comme un « glissement très dangereux ». Il s’agit de lieux d’hébergement assortis de mesures de contrôle et d’expulsion, selon lui : « En gros, on vous dit on vous héberge mais en échange vous allez être assigné à résidence et venir pointer. » L’effet dissuasif est immédiat : « Les gens ne sont pas fous », ils refusent d’y aller, craignant de se retrouver « dans les feux de la préfecture » et d’être expulsés « demain matin ».
Cette évolution inquiète la Cimade, qui y voit un durcissement supplémentaire des conditions d’hébergement pour les étrangers sans titre. Si le dispositif n’existe pas encore dans le Loir-et-Cher, la généralisation de ces centres ne peut être exclue.
Régulariser pour sortir de l’impasse
La conclusion tirée par Guillaume Marsallon est nette : l’accès au titre de séjour est incontournable. « L’accès à un titre de séjour, c’est la clé de la sortie de la précarité », a-t-il affirmé. Sans cela, impossible pour les travailleurs sociaux, les associations, les acteurs du logement et de l’hébergement d’offrir des solutions durables. Tout est conditionné par la régularisation. Et cette dernière, selon lui, ne dépend pas uniquement de nouvelles lois. « Les préfectures ont ce qu’on appelle un pouvoir de régularisation permanente », a-t-il rappelé, rejetant l’idée selon laquelle l’administration serait les mains liées.
Il en résulte deux stratégies possibles, selon Marsallon : celle des expulsions, prônée par certains responsables politiques, ou celle de la régularisation, qui permettrait de « sortir par le haut ». Il souligne que si les personnes aujourd’hui dans les dispositifs d’hébergement d’urgence obtenaient un titre de séjour, elles quitteraient rapidement ces places précaires. « La clé, on sait où elle est », a-t-il souligné. La question est de savoir si, politiquement, l’on souhaite l’utiliser.