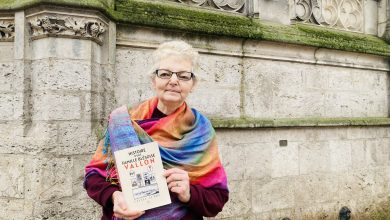L’Annus Domini : ce système de datation qui nous fait passer en 2025

Au VIe siècle, dans le silence des cloîtres et sous l’autorité de Rome, un moine du nom de Denys le Petit (Dionysius Exiguus) répondit à une commande du pape Jean Ier. Ce moine scythe, connu pour sa maîtrise des calculs et son érudition, fut chargé de mettre en ordre les dates mouvantes de Pâques, une fête centrale dans le christianisme. Dans ce cadre précis et sous cette impulsion pontificale, il introduisit ce qui deviendra l’Annus Domini – « l’année du Seigneur » –, un système de datation fondé sur la naissance supposée de Jésus-Christ.
Contexte historique : un temps dispersé
Avant l’instauration de ce système, le passage des années se mesurait selon des références variées, souvent éloignées de la spiritualité chrétienne. Les Romains comptaient les années depuis la fondation de Rome (Ab Urbe Condita, 753 av. J.-C.) ou en fonction des consuls en fonction. Dans l’Église, on utilisait parfois l’ère des martyrs, basée sur le règne de l’empereur Dioclétien, tristement célèbre pour ses persécutions contre les chrétiens. Cependant, cette référence païenne et violente était de plus en plus mal perçue. L’Église aspirait à un système de datation reflétant la centralité de la foi chrétienne. C’est dans ce contexte que Denys le Petit fut convoqué pour apporter une solution.
La création de l’Annus Domini
En 525, Denys le Petit entreprit de recalculer les cycles pascals à la demande du pape Jean Ier. Ce travail, complexe, exigeait une rigueur mathématique et astronomique. Denys abandonna le système en vigueur, lié à Dioclétien, qu’il jugeait inapproprié. Il proposa alors un nouveau point de départ pour le calendrier : la naissance de Jésus-Christ. Pour fixer cette année fondatrice, Denys s’appuya sur les connaissances disponibles à son époque – sources bibliques, historiques et astronomiques. Il estima que la naissance du Christ avait eu lieu 525 ans avant son propre temps, plaçant ainsi cette année comme l’Anno Domini 1. Notons que Denys ignorait la notion d’année zéro, inexistante dans son système numérique.
Un calcul imparfait
Les recherches modernes révèlent cependant des erreurs dans l’évaluation de Dionysius Exiguus. Les Évangiles situent la naissance de Jésus sous le règne du roi Hérode le Grand, mort en 4 av. J.-C., ce qui signifie que Jésus serait né avant l’Anno Domini 1. Des indices historiques et astronomiques suggèrent une date de naissance comprise entre 7 et 4 av. J.-C. Ces imprécisions, bien qu’importantes, ne diminuaient pas l’objectif initial de Denys : créer un repère symbolique et universel pour la chrétienté.
Diffusion lente et adoption universelle
L’Annus Domini ne fut pas immédiatement adopté. Ce n’est qu’au VIIIe siècle, via Bède le Vénérable, que le système se répandit dans le monde chrétien occidental. Dans son Histoire ecclésiastique du peuple anglais, Bède utilisa ce système pour structurer son récit, contribuant à sa diffusion. Au IXe siècle, Charlemagne imposa l’Annus Domini dans son empire, consolidant ainsi son usage dans l’Europe médiévale. Plus tard, les années précédant l’Anno Domini 1 furent définies comme « avant Jésus-Christ » (avant J.-C.), créant ainsi un continuum temporel.
Un héritage durable
Aujourd’hui, le système introduit par Denys le Petit demeure la base du calendrier grégorien, utilisé dans le monde entier. Cependant, il coexiste avec d’autres systèmes de datation, comme les calendriers musulman, juif ou bouddhiste. Loin d’être l’œuvre d’un génie solitaire, l’Annus Domini s’inscrit dans un contexte précis de commande ecclésiastique et répond à des besoins spirituels et pratiques. Denys, en tant qu’exécutant rigoureux, contribua à inscrire le temps chrétien dans le cadre de l’histoire humaine.