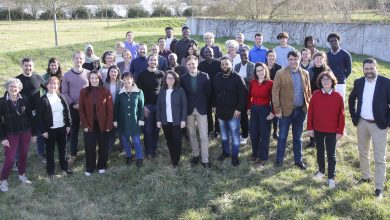Hydrologie régénérative : repenser nos paysages pour cultiver l’eau

L’eau ne se résume ni à un volume à répartir, ni à un flux à canaliser. Elle est un cycle vivant, que l’on peut réparer. Et même cultiver. C’est cette conviction que défend Samuel Bonvoisin, figure française de l’hydrologie régénérative. À rebours des approches techniciennes de la « gestion de l’eau », il propose de redonner toute sa place au vivant — forêts, sols, haies, bactéries, castors — pour restaurer les équilibres écologiques et climatiques. Non, l’eau ne tombe pas du ciel sans raison. Elle naît des paysages. Et nous savons déjà comment faire pleuvoir. C’est ce qu’il a expliqué lors d’une conférence, à Blois, au CCI Campus Centre, un évènement organisé conjointement par le Lions Club Blois Doyen et le Lions Club Blois Renaissance.
Restaurer les cycles de l’eau verte
« Deux tiers des pluies continentales proviennent de l’évapotranspiration : de l’eau transpirée par les végétaux et évaporée par les sols », rappelle Samuel Bonvoisin. C’est ce qu’on appelle l’eau verte, par opposition à l’eau bleue, visible dans les rivières, les lacs ou les nappes. « L’eau verte est très peu connue du grand public, mais elle est essentielle. On parle ici du recyclage de l’eau sur les continents, avant qu’elle ne reparte vers l’océan. »
Ce cycle de l’eau verte a été « brisé ». À l’origine : le remembrement, l’arrachage des haies, le comblement des mares, la rectification des cours d’eau, l’imperméabilisation des sols. « On a tout fait pour que l’eau s’évacue plus vite. Résultat : elle n’a plus le temps d’infiltrer les sols, de les nourrir, de les rafraîchir. » En parallèle, les sols se sont appauvris. « Le taux de matière organique dans les sols agricoles est passé de 4 % en 1950 à 1,5 % aujourd’hui. Or, un seul pour cent de matière organique permet de retenir 250 m³ d’eau par hectare sur 15 cm de sol. » Derrière ces chiffres, une conséquence directe : les paysages perdent leur capacité à retenir l’eau, donc à réguler la température, à alimenter les nappes, à alimenter l’atmosphère… et à faire pleuvoir.
Changer de paradigme
L’approche que propose Samuel Bonvoisin ne se limite pas à un ensemble de pratiques agricoles. Il s’agit d’un changement complet de perspective. « On est dans un paradigme où, face à une inondation, le réflexe, c’est de curer les fossés, d’évacuer l’eau le plus vite possible. Mais c’est exactement l’inverse qu’il faudrait faire : ralentir l’eau, la faire infiltrer, stocker l’humidité dans le paysage. »
Ce renversement s’incarne dans les quatre piliers de l’hydrologie régénérative : ralentir, infiltrer, stocker, evapotranspirer. C’est tout un art d’aménager les paysages pour qu’ils se comportent comme des éponges vivantes. « On distingue la gestion horizontale — ralentir l’eau de surface — et la gestion verticale — accélérer sa pénétration dans les sols. »
Parmi les techniques évoquées : l’agroforesterie, l’enherbement, l’agriculture de conservation des sols, mais aussi le Keyline design, qui consiste à travailler selon les lignes de niveau. « On peut aussi restaurer les méandres, déconnecter les chemins agricoles du réseau hydrographique naturel, ou créer des bassins d’infiltration. » Mais ce que l’expert appelle de ses vœux, c’est surtout un changement d’échelle. « L’action individuelle est utile pour faire connaître ces approches, mais elle est inefficace sur la ressource elle-même. Il faut des politiques publiques offensives. »
L’exemple du castor, ingénieur hydrologue
Pour illustrer ce changement de regard, Samuel Bonvoisin convoque un animal : le castor. « Il a habité toutes les rivières de l’hémisphère nord pendant huit millions d’années. Et depuis des siècles, on l’a presque totalement éradiqué. » Une erreur historique, selon lui. Le castor, par son mode de vie, ralentit les eaux, recrée des zones humides, recharge les nappes, stocke du carbone, et lutte contre les incendies. « C’est ce qu’a démontré la chercheuse Emily Fairfax. Depuis 2022, le GIEC recommande la préservation et la réintroduction du castor comme solution climatique. » Ce qui a été fait il y a 50 ans à Blois.
Accepter que le vivant sait mieux que nous
Mais cette réintroduction se heurte à une réalité : celle de nos usages. « Le long des rivières, on a mis des routes, des lotissements, des zones d’activité. Le retour du castor questionne : est-ce qu’on continue à vouloir tout contrôler ? Ou est-ce qu’on accepte que le vivant sache mieux que nous ? On commence à construire des barrages analogues à ceux du castor, en s’inspirant de ses techniques. On peut redevenir des artisans de la régénération des cycles. »
Réapprendre à faire pluie
Ce que Samuel Bonvoisin tente de transmettre, ce n’est pas seulement une méthode, c’est une éthique. « Est-ce que notre rôle est d’extraire, de dégrader, de polluer ? Ou est-ce qu’il est de régénérer, de prendre soin, de remettre les cycles en route ? » Selon lui, on n’a pas besoin d’attendre de nouvelles technologies. « On sait déjà comment faire. Avec les connaissances et les outils qu’on a, on peut commencer dès aujourd’hui. »
Ce message, il le porte aussi bien devant des élus que dans les écoles. À Cellettes, à Blois, comme ailleurs, il commence souvent par parler aux enfants. « Je leur présente les huit super-héros des cycles de l’eau : le castor, le lierre, la ronce, la bactérie Pseudomonas syringae, les arbres… et le huitième, c’est nous. Parce que nous aussi, on peut agir. »

Pour les adultes, la conférence devient plus technique, plus philosophique. « Je leur parle de mycorhizes, d’interconnexions entre milieux, mais aussi de posture. Est-ce qu’on veut juste s’adapter, ou est-ce qu’on veut régénérer ? » Selon lui, l’adaptation — aussi nécessaire soit-elle — ne suffit pas. « Elle part du principe qu’on va faire moins pire. La régénération, c’est faire mieux. » Et contrairement aux idées reçues, cela ne prend pas plus de temps. « En Inde, un programme d’hydrologie régénérative a produit des résultats spectaculaires en quatre ans. »
Ce que propose l’hydrologie régénérative, au fond, ce n’est pas une simple gestion de l’eau. C’est un regard renouvelé sur le vivant. « On ne fait pas pleuvoir par magie. Mais on peut créer les conditions où la pluie devient plus probable. Il faut réapprendre à faire pluie. » Ce travail d’explication est exigeant. « Ce cycle de l’eau verte, ce recyclage continental, c’est invisible. Mais chaque fois qu’on remplace un jardin vivant par du gravier et deux palmiers, on fabrique un désert. »
À rebours d’un monde qui accélère et simplifie, Samuel Bonvoisin nous invite à ralentir et à complexifier. Non par nostalgie d’un état de nature, mais pour retrouver, dans nos gestes et nos paysages, une manière de cohabiter. Humble, durable, féconde.