Bac Philo 2024 : les sujets et des éléments de correction
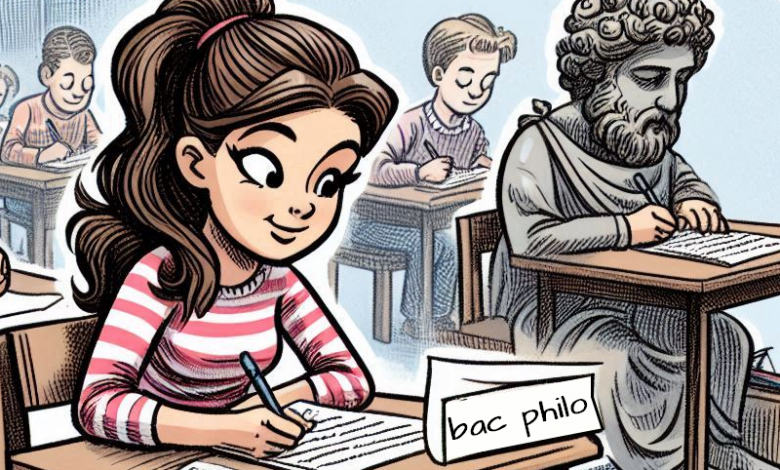
Ce mardi 18 juin, la traditionnelle épreuve de philosophie, emblématique du baccalauréat, a ouvert le bal des examens finaux pour des centaines de milliers de lycéens à travers la France. Un moment à la fois redouté et attendu, qui symbolise pour beaucoup la fin de leur parcours au lycée et le début d’une nouvelle étape de leur vie académique et professionnelle.
Cette année, ce sont 392.145 élèves de la voie générale et 151.224 élèves de la voie technologique qui ont pris place devant leur copie pour affronter les sujets de philosophie. Environ 3.000 candidats étaient inscrits dans le département du Loir-et-Cher. Les thèmes abordés lors de ce Bac Philo 2024 ont une nouvelle fois plongé les élèves dans des réflexions profondes sur la condition humaine, la société, et les grands questionnements existentiels.
Les sujets de philosophie en voie générale
Les candidats de la voie générale avaient le choix entre deux sujets de dissertation et un sujet d’explication de texte :
- Dissertation 1 : « La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ? »
- Dissertation 2 : « L’État nous doit-il quelque chose ? »
- Explication de texte : Un extrait de La Condition ouvrière de Simone Weil.
« La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ? »
La question de savoir si la science peut satisfaire notre besoin de vérité touche à la fois aux limites de la connaissance scientifique et aux dimensions philosophiques de la vérité. La science, dans son essence, cherche à expliquer les phénomènes naturels à travers des méthodes systématiques et reproductibles, proposant des théories vérifiables par l’expérimentation et l’observation.
Tout d’abord, il est essentiel de reconnaître que la science ne prétend pas détenir une vérité absolue mais offre plutôt des modèles qui correspondent le mieux aux données observées. Ces modèles sont constamment remis en question et affinés à mesure que de nouvelles données sont disponibles. Ainsi, la science est dynamique, évolutive, et toujours en quête de précisions.
Cependant, la science a ses limites. Certains phénomènes, surtout ceux liés à la conscience, aux émotions ou à des expériences subjectives, échappent souvent à une compréhension pleinement scientifique. De plus, les questions métaphysiques, comme celles concernant l’existence de Dieu ou le sens de la vie, ne peuvent être résolues par des méthodes scientifiques.
D’autre part, la notion de vérité en science est souvent probabiliste plutôt qu’absolue. Les scientifiques parlent de degrés de confiance et de probabilités plutôt que de certitudes incontestables. Cela illustre une forme de modestie épistémologique, reconnaissant que ce que nous savons est limité par nos outils de mesure et notre compréhension actuelle.
En philosophie, la vérité peut être envisagée de manière plus abstraite et moins dépendante des faits observables. Les philosophes s’interrogent sur des vérités éternelles ou des principes moraux qui ne sont pas toujours ancrés dans le concret observable que la science traite.
La science peut toutefois contribuer à une forme de vérité pratique, aidant à résoudre des problèmes concrets et à améliorer notre interaction avec le monde. Par exemple, grâce aux avancées médicales, nous comprenons mieux comment traiter certaines maladies, ce qui peut être considéré comme une approche de la vérité en termes de résultats pratiques.
Il est aussi important de noter que la science est limitée par les paradigmes en cours, qui façonnent ce que les scientifiques choisissent d’étudier et comment ils interprètent leurs résultats. Thomas Kuhn, dans son œuvre sur la structure des révolutions scientifiques, a bien illustré comment les changements de paradigmes peuvent amener à de nouvelles compréhensions, suggérant que la vérité scientifique n’est pas statique.
Si la science est un puissant outil de découverte et d’explication du monde naturel, elle ne peut à elle seule satisfaire tous les aspects de notre quête de vérité. Elle doit être complétée par d’autres formes de recherche et de réflexion, comme la philosophie, l’art, et la spiritualité, qui explorent d’autres dimensions de l’expérience humaine et proposent d’autres formes de vérité. La complémentarité entre ces diverses approches enrichit notre compréhension globale et notre appréciation de ce qui est vrai.
L’État nous doit-il quelque chose ?
L’interrogation sur ce que l’État nous doit est liée à l’actualité, et fondamentale en philosophie politique, en droit et dans les débats publics contemporains. Elle touche à la notion de contrat social, concept clé depuis les philosophes des Lumières comme Rousseau, qui envisageait l’État comme un accord mutuel entre les gouvernants et les gouvernés.
Premièrement, l’État doit garantir les droits fondamentaux des citoyens, tels que la liberté, l’égalité et la sécurité. Ces droits sont souvent inscrits dans les constitutions et représentent le minimum que l’État doit fournir à ses citoyens. De plus, l’État a le devoir de protéger ses citoyens contre les menaces internes et externes, ce qui justifie l’existence de forces de l’ordre et de l’armée.
Sur le plan économique, certains théoriciens affirment que l’État doit assurer une certaine forme de justice sociale, réduisant les inégalités et fournissant des filets de sécurité sociale tels que l’assurance maladie, l’aide au logement, et les allocations chômage. Cela est fondé sur l’idée que l’État doit jouer un rôle actif dans la création de conditions équitables pour tous.
L’État a également des responsabilités en matière d’éducation. En fournissant une éducation gratuite et accessible à tous, il permet l’égalité des chances et promeut le mérite personnel. Cela est crucial pour le développement personnel des citoyens et pour la compétitivité.
En matière de santé, l’obligation de l’État peut varier selon les modèles politiques et économiques des pays, mais l’accès universel aux soins de santé est souvent vu comme un devoir étatique, permettant ainsi de garantir le bien-être de la population.
L’État doit aussi protéger l’environnement. Avec l’augmentation de la prise de conscience écologique, il est devenu impératif que l’État impose des règlements pour la conservation des ressources naturelles et la réduction de la pollution.
Cependant, l’extension des devoirs de l’État soulève des questions sur les limites de son intervention dans la vie des individus. Certains critiques, notamment des libertariens, argumentent que l’État ne devrait intervenir que pour garantir les libertés individuelles et protéger les citoyens contre les abus.
Bien que l’ampleur et la nature des devoirs de l’État puissent varier selon les contextes nationaux et les idéologies, il est généralement admis que l’État doit quelque chose à ses citoyens. Ce « quelque chose » englobe la protection des droits fondamentaux, la promotion de la justice sociale, l’éducation, la santé, et la protection de l’environnement. La détermination précise de ces devoirs reste toutefois un sujet de débat politique et philosophique intense.
Les sujets de philosophie en voie technologique
Les élèves de la voie technologique ont également eu à choisir entre deux sujets de dissertation et un texte à expliquer :
- Dissertation 1 : « La nature est-elle hostile à l’homme ? »
- Dissertation 2 : « L’artiste est-il maître de son travail ? »
- Explication de texte : Un extrait des Lois de Platon.
Un marathon d’épreuves
L’épreuve de philosophie marque le début d’une série d’examens pour les élèves de terminale. Après cette première épreuve, les élèves enchaînent avec trois jours d’épreuves de spécialité jusqu’à ce vendredi. Par la suite, ils devront se préparer pour le Grand Oral, prévu entre le 24 juin et le 3 juillet, une épreuve introduite récemment dans le baccalauréat pour évaluer leurs compétences oratoires et leur capacité à argumenter de manière claire et structurée. Pour les élèves du baccalauréat professionnel, les écrits se poursuivront jusqu’au 26 juin.







