Visages d’ancêtres : un projet mémoriel d’envergure au Château de Blois

L’exposition « Visages d’ancêtres. Retour à l’île Maurice pour la collection Froberville » se tient au Château royal de Blois jusqu’au 1er décembre 2024. Elle est le moyen de la redécouverte et la réhumanisation des captifs africains déportés dans l’océan Indien au XIXe siècle.
Ce projet, conduit par l’historienne Klara Boyer-Rossol, en collaboration avec la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage et le Musée de l’esclavage intercontinental de Port-Louis à l’île Maurice, réunit une approche historique, scientifique et mémorielle pour restituer une voix à ceux dont les visages ont été figés dans des bustes anthropologiques en 1846.
La genèse de la collection Froberville : un témoignage anthropologique
L’histoire de la collection Froberville commence en 1846, lorsque Eugène de Froberville, ethnographe franco-mauricien, entreprend de mouler les visages de captifs africains déportés à l’île Maurice. À cette époque, l’île avait déjà aboli l’esclavage en 1835, mais la traite illégale continuait. Les captifs, principalement issus des régions du Mozambique et de la Tanzanie, étaient déportés dans l’océan Indien pour travailler dans les plantations de canne à sucre qui prospéraient alors.
Klara Boyer-Rossol, à l’origine de cette exposition, explique que Froberville avait une motivation scientifique marquée par le courant de la science des races, en vogue au XIXe siècle. « Ces bustes, bien qu’inscrits dans une démarche anthropologique, témoignent de la vie de ces hommes et de ces femmes », affirme-t-elle. Froberville, dans son enquête, chercha à recueillir des informations ethnographiques auprès de ces captifs, collectant non seulement leurs visages moulés, mais aussi des récits sur leurs origines, leurs langues et leurs pratiques culturelles.

Le projet anthropologique de Froberville, bien que marqué par les préjugés de son époque, nous permet aujourd’hui de mieux comprendre les contextes sociaux, économiques et humains de ces captifs, à travers un regard renouvelé, loin des idées racistes qui entouraient ces recherches à l’époque.
Un travail scientifique de longue haleine
La collection Froberville, composée à l’origine de 63 bustes, fut longtemps oubliée dans les réserves du Château royal de Blois. Après avoir été envoyée au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris en 1874, des copies furent réalisées, mais l’ensemble de la collection originale resta largement méconnu. Ce n’est qu’en 2018 que Klara Boyer-Rossol eut accès aux bustes et aux archives privées de la famille Froberville, lui permettant ainsi de mener un travail de recherche minutieux.

« Ce travail de réhumanisation a consisté à replacer chaque individu dans son contexte historique et culturel », explique-t-elle. Parmi les 140 informateurs africains interrogés par Froberville à Maurice et Bourbon (actuelle Réunion), Boyer-Rossol a pu identifier 56 des 58 individus moulés, reconstituant leur nom d’origine, leur parcours et parfois même leurs histoires personnelles. « Nous avons découvert des récits exceptionnels qui témoignent de la vie de ces personnes », ajoute-t-elle.
Des récits de vie reconstitués
L’exposition « Visages d’ancêtres » ne se contente pas de présenter des bustes. Elle offre également un aperçu de la réalité humaine de ces captifs, en restituant leurs récits de vie. Parmi les plus marquants, on trouve celui de João, un captif originaire du Mozambique, dont le visage a été moulé à trois reprises. João, devenu un informateur clé pour Froberville, a passé plusieurs jours à raconter à l’ethnographe sa vie avant la déportation, fournissant des récits détaillés sur son pays d’origine, sa langue et sa culture.

Boyer-Rossol a également retracé l’histoire des captifs du navire Lily, intercepté en 1840. Ces captifs, déportés vers Maurice, ont été libérés de la traite illégale mais se sont retrouvés sous le statut ambigu de travailleurs engagés, continuant ainsi d’être exploités dans les plantations de l’île. Parmi eux, plusieurs captifs ont vu leur visage moulé, et Boyer-Rossol a pu identifier 21 individus du Lily.
Un autre exemple marquant est celui de la découverte récente du buste d’une femme, une des rares représentées dans la collection. Klara Boyer-Rossol raconte que ce buste fut retrouvé dans les réserves du Musée de l’Homme à Paris, en décembre 2023 : « C’était une découverte extraordinaire. Cette femme faisait partie des captifs du Lily, déportée à Maurice à l’âge de 19 ans. »
Le rôle des femmes dans l’enquête de Froberville
Les femmes sont sous-représentées dans cette collection, avec seulement deux bustes identifiés. Cette faible proportion s’explique à la fois par les choix économiques des planteurs, qui recherchaient principalement des hommes pour travailler dans les champs de canne, mais aussi par les normes sociales de l’époque. « Je pense que Eugène de Froberville aurait été gêné de passer des journées entières avec des femmes africaines, ce qui explique leur faible présence dans ses recherches », analyse Klara Boyer-Rossol. Ces normes sociales, dictées par l’aristocratie à laquelle appartenait Froberville, limitaient ainsi l’accès aux récits des femmes captives.
Un partenariat France – Maurice
Cette exposition revêt une dimension internationale, reliant la France et l’île Maurice dans un projet commun de restitution mémorielle. Les bustes seront prêtés au Musée de l’esclavage intercontinental de Port-Louis, où ils constitueront une pièce maîtresse de la collection permanente du musée. « Il y a une attente immense autour de ces bustes à Maurice », souligne Boyer-Rossol. Ce projet de prêt, soutenu par la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, témoigne de l’importance de ces bustes pour les descendants des captifs, qui voient dans ces visages un lien tangible avec leurs ancêtres.
Pierre-Yves Bloquet, directeur adjoint de la Fondation, insiste sur la portée symbolique de cette restitution : « Ce projet permet de redonner une dignité et une humanité à ces personnes en leur restituant leurs histoires, leurs mémoires, et en les transmettant à leurs descendants. »
Une symbolique forte dans un lieu historique
L’exposition se déroule dans un lieu hautement symbolique, le Château royal de Blois, résidence de François Ier, symbole de la puissance monarchique française et de l’aventure coloniale initiée sous son règne. Pierre-Yves Bloquet souligne l’importance de ce cadre : « Ce château, emblème de l’histoire royale française, rappelle que l’histoire de l’esclavage est intimement liée à celle de la colonisation, initiée sous François Ier avec l’exploration du ‘Nouveau Monde’ par Jacques Cartier. »
Cet ancrage historique et symbolique du Château de Blois fait écho à l’histoire coloniale française, marquée par des figures telles que Louis XIII, Richelieu et Louis XIV, tous impliqués dans la construction de l’empire colonial. En exposant ces bustes au Château de Blois, l’exposition « Visages d’ancêtres » montre que l’histoire de l’esclavage n’est pas isolée des grandes figures historiques françaises, mais qu’elle en fait pleinement partie.

Une exposition pour réhumaniser les victimes de l’esclavage
L’objectif de cette exposition est de réhumaniser les captifs africains qui, pendant des siècles, ont été réduits au silence. « Il s’agit de donner une voix à ceux qui ont été déshumanisés », explique Klara Boyer-Rossol. Ce travail de restitution passe par la reconstitution des récits de vie, mais aussi par une approche micro-historique, qui permet de se concentrer sur l’individu plutôt que sur les statistiques de la traite négrière.
Boyer-Rossol insiste sur l’importance de replacer ces personnes dans leur contexte culturel et social : « Les captifs n’étaient pas simplement des chiffres dans les registres, ils avaient des noms, des familles, des histoires. Notre objectif est de restituer cette humanité à travers les récits que nous avons pu reconstituer. »
Une résonance contemporaine : de l’histoire à la mémoire
L’exposition « Visages d’ancêtres » ne se limite pas à une simple présentation d’objets historiques, elle fait écho aux luttes contemporaines contre le racisme et les discriminations. Comme le souligne Pierre-Yves Bloquet, « l’histoire de l’esclavage continue d’alimenter les préjugés racistes et les stéréotypes qui existent encore aujourd’hui. » Cette exposition invite ainsi le public à repenser l’histoire de l’esclavage non pas comme un phénomène du passé, mais comme un héritage qui continue de résonner dans nos sociétés actuelles.
Une restitution mémorielle
L’exposition « Visages d’ancêtres. Retour à l’île Maurice pour la collection Froberville » est une nouvelle étape dans un projet en constante évolution. Klara Boyer-Rossol poursuit son travail de recherche de provenance, dans l’espoir de reconstituer les récits de vie des 58 individus représentés dans les bustes. « Mon objectif est de donner à chacun de ces captifs une histoire complète », explique-t-elle.
Cette exposition permet de redonner une voix et une dignité à ceux qui ont été réduits au silence. Elle invite également à réfléchir sur le rôle de la science et de la colonisation dans la déshumanisation des individus, tout en montrant que l’histoire de l’esclavage est intimement liée à celle de la France.






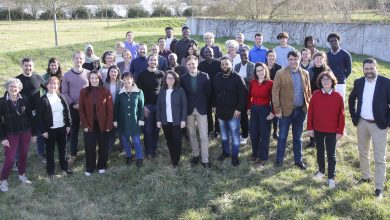
Eugène de Froberville s’est intéressé, avant tout, à la vie des se informateurs, la société dans laquelle ils sont nés, l’organisation de leur tribu, les coutumes, la langue, et enfin leur parcours de captifs. Cette démarche, hors de tout aspect d’intérêts commerciaux, était tout fait novatrice en 1845. Sa collecte d’informations auprès d’esclaves à Bourbon, et d’anciens captifs à Maurice, s’est parfois heurtée à l’incompréhension des colons. Dan un courrier en date du 28 mars 1846, il note :
« Mes instans de repos étaient consacrés à l’étude des africains qui cultivaient les plantations. Idiomes curieux tout à fait inconnus en Europe et dont j’avais formé le projet de former des vocabulaires. Je passais mes journées à interroger ces malheureux esclaves, à écouter la navrante histoire de leur vie. Les colons ne pouvaient comprendre l’intérêt que j’attachais à ce travail, quelques uns souriaient de mépris. Causer avec un noir, chercher sous cette laide enveloppe des sentimens et des idées ! Il faut avoir bien du temps à perdre, disent ils ».
Pour mener ses entretiens et recueillir ainsi une somme considérable de savoirs, Eugène de Froberville s’est aidé de la confiance donnée par ces populations au père Jacques-Désiré Laval, personnalité bien connue et révérée des anciens captifs de l’ile Maurice. Humaniste et respectueux des êtres, Eugène de Froberville a redonné toute leur humanité à ces populations qui en avaient été privé. Le consentement de ses informateurs était pleinement acquis, autant pour répondre à ses questions que pour recueillir l’empreinte de leur visage. Ne serait ce qu’en douter est faire une inacceptable offense à Eugène de Froberville tout autant qu’à ses informateurs.
Pour la mémoire et l’histoire de ces populations, hors de toutes polémiques infécondes, laissons parler les notes recueillies par Eugène de Froberville pour ce qu’elles sont : l’unique et irremplaçable mémoire de ces peuples.