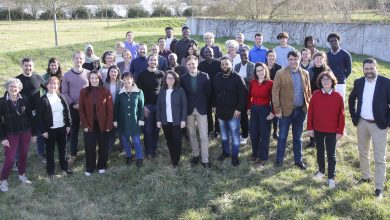82% des proches ayant reçu un coming out ont une bonne image des LGBT+

À l’occasion de la Journée internationale du Coming Out, l’Association Contact, en collaboration avec Ipsos et la Fondation Jean-Jaurès, a publié une enquête inédite sur l’impact du coming out au sein des familles et des proches en France. Cette étude, réalisée entre le 21 et le 24 juin 2024 auprès de 1 896 personnes ayant reçu un coming out (CO), met en lumière les réactions et perceptions face à ces révélations, tout en pointant certaines disparités inquiétantes. Si l’acceptation globale est majoritaire, elle varie fortement selon l’âge, le genre et les opinions politiques.
Une acceptation largement majoritaire
L’enquête révèle que 82 % des personnes ayant reçu un coming out de la part d’un proche ont aujourd’hui une bonne image des personnes LGBT+. Ces résultats témoignent d’un climat d’acceptation globalement favorable au sein de la société française. Près de 80 % des répondants déclarent avoir ressenti des émotions positives lors de l’annonce, telles que l’amour, la fierté ou la sérénité. Cette tendance s’inscrit dans un contexte où la lutte contre les discriminations est devenue un enjeu de plus en plus important, notamment face à l’augmentation des actes LGBTphobes en France.
Toutefois, malgré cette majorité d’opinions positives, l’étude pointe des disparités selon certains critères socio-démographiques. Par exemple, 24 % des hommes et 26 % des personnes de moins de 35 ans ayant reçu un coming out conservent une image négative des personnes LGBT+, contre 18 % pour l’ensemble des répondants. Ces chiffres révèlent des résistances plus marquées dans certaines tranches de la population, en particulier chez les jeunes hommes.
Des réactions plus mitigées pour les coming out trans
L’étude met également en avant une difficulté accrue pour les coming out liés à l’identité de genre. En effet, 26 % des personnes interrogées considèrent qu’un coming out trans est plus difficile à accepter qu’un coming out lié à l’orientation sexuelle. Ces résultats s’expliquent par la persistance de préjugés et de méconnaissances autour des questions d’identité de genre, mais aussi par les inquiétudes accrues quant aux discriminations et violences subies par les personnes trans.
Cette réticence est particulièrement marquée chez les jeunes hommes : 15 % des hommes de moins de 25 ans déclarent que l’annonce d’un coming out a eu un impact négatif sur leur relation avec la personne concernée, contre 8 % en moyenne pour l’ensemble des répondants. Ces chiffres suggèrent que les représentations traditionnelles de la masculinité peuvent constituer un obstacle à l’acceptation des identités de genre non conformes.
Un soutien familial en progression
Le rôle de la famille dans l’acceptation des coming out est également au cœur de l’étude. L’acceptation par les parents, notamment, évolue de manière significative avec le temps : si seulement 48 % des parents acceptaient complètement l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de leur enfant au moment de l’annonce, ce chiffre atteint 71 % aujourd’hui. Cette progression démontre l’importance du dialogue et du temps dans le processus d’acceptation.
Cependant, l’étude révèle également que 17 % des coming out ont été appris indirectement, sans le consentement explicite de la personne concernée, ce qui met en lumière des enjeux éthiques liés à l’outing. L’importance du respect de la vie privée et du consentement est rappelée, notamment dans les discussions au sein des cercles familiaux et amicaux.
Le besoin de soutien après le coming out
Le soutien apporté par les associations est également mis en avant dans l’étude. En effet, 72 % des personnes interrogées estiment qu’il est utile de s’adresser à des associations après avoir reçu un coming out. Toutefois, seules 15 % des personnes ayant reçu un CO ont effectivement sollicité l’aide d’une association. Ce décalage souligne la nécessité de rendre ces ressources plus accessibles et visibles pour les familles et les proches.
Par ailleurs, l’enquête révèle que les discussions autour du coming out sont souvent initiées par les personnes ayant reçu l’annonce, et que ces discussions sont jugées utiles dans plus de 50 % des cas. Le dialogue est perçu comme un outil central dans l’acceptation et la compréhension des réalités LGBT+, même si ces échanges restent parfois difficiles, notamment dans les situations où la nouvelle a été perçue comme un choc.
Un clivage politique marqué
L’enquête montre aussi un fort clivage politique en ce qui concerne le soutien à la cause LGBT+. Si 83 % des personnes se déclarant proches des partis de gauche soutiennent cette cause, seulement 47 % des sympathisants d’extrême droite partagent cet avis. Ce clivage se retrouve également dans la perception des personnes LGBT+ : 39 % des personnes se situant à l’extrême droite ont une mauvaise image des personnes LGBT+, contre seulement 18 % pour l’ensemble des répondants.