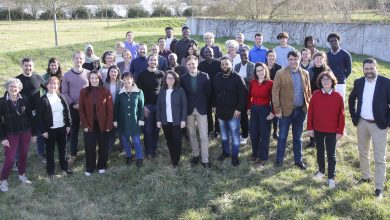Lola Lafon : « L’inquiétude est liée au fait d’être vivant »
Publié le 8 janvier 2025 aux éditions Stock, Il n’a jamais été trop tard de Lola Lafon rassemble une série de chroniques initialement écrites pour le journal Libération entre janvier 2023 et novembre 2024. Enrichies de réflexions personnelles inédites, ces textes mêlent observations sur l’actualité — guerre en Ukraine, révolte iranienne, meurtre de Nahel, procès de Mazan — et fragments d’intimité. L’autrice y aborde notamment la figure de son père ou la vieillesse de son chien, dans une écriture qui interroge notre rapport au monde, à la mémoire, à l’espoir.
Le mardi 13 mai 2025, Lola Lafon était invitée à l’Hôtel de Ville de Blois par Annie Huet, pour une nouvelle édition des célèbres rencontres littéraires qu’elle anime. Une conversation dense, marquée par la fidélité entre l’écrivaine et son hôte, mais aussi par une communauté de regard sur l’intranquillité du monde et le rôle que la littérature peut encore y tenir.
Très vite, Annie Huet pointe la structure fragmentaire du livre : des textes qui s’apparentent à des nouvelles — « des nouvelles du monde et de toi », dit-elle à l’autrice. Elle note que la littérature de Loal Lafon ouvre toujours des espaces, des portes vers l’intime et vers le dehors. Ce que Lola Lafon revendique sans détour : elle écrit avec le sentiment des autres, mais jamais pour eux. Écrire pour les autres, dit-elle, ce serait disparaître, céder au désir d’autrui, et « il n’y aurait plus aucune honnêteté ». Ce serait « être publicitaire, quasiment ». Elle poursuit : « Quand j’écris un roman j’ai toujours en tête, dans un sens positif, des gens avec qui j’ai commencé une conversation il y a vingt ans. »

Ce livre est donc né dans un contexte particulier : une proposition du journal Libération de tenir une page blanche chaque mois. « J’ai demandé si je pouvais tout écrire », raconte-t-elle. On lui répond oui. Et elle saisit alors que cette liberté est une chance, mais aussi une responsabilité. Les fragments tissent un lien avec le réel — celui de l’actualité comme celui du corps vieillissant d’un chien, compagnon fidèle devenu trop vieux pour le regard des passants. « Il fallait qu’il sorte du paysage », dit-elle, évoquant le rejet dont il fut l’objet. Elle raconte qu’un célèbre magazine féminin, à qui elle avait proposé ce texte, n’a pas voulu le publier tel quel : « On ne saurait parler de la vieillesse, de la dégradation du corps », lui dit-on, parce que les sponsors sont des marques de cosmétique.
L’éloge de l’inquiétude comme forme de présence au monde
Ce rejet rejoint pour Lola Lafon une lecture plus large : celle du traitement social de la fragilité, des lenteurs, du désordre et du vacillement. Dans ce petit livre, commente Annie Huet, il y a « un éloge de la fragilité qui est très beau ». Et parmi les mots clefs, l’inquiétude. L’autrice en fait l’objet d’un texte. Elle commence par chercher sa définition sur Internet : une dizaine de pages de thérapeutes et coachs lui expliquent comment s’en débarrasser. Mais elle s’arrête sur le sens profond, sur l’étymologie : « L’inquiétude, c’est celle qui est en mouvement. C’est l’intranquillité. » Elle s’étonne de cette époque où l’on voudrait supprimer tout ce qui bouge, tout ce qui trouble, tout ce qui fait vivre. « Être inquiet, c’est être vivant », affirme-t-elle, regrettant ces sondages où l’on découvre que « le vol du téléphone portable est loin devant le sort de la planète » dans la liste des préoccupations des Français. Et ce pourcentage de gens qui disent ne s’inquiéter de rien lui semble tout simplement… très inquiétant.
Ce que la société attend encore des hommes : une parole manquante
À propos du procès concernant Gisèle Pélicot, Annie Huet remarque que c’est la première fois qu’on désigne une affaire par le prénom de la victime, et non plus celui de l’agresseur. Ce n’est plus un fait divers : c’est un fait de société. Lola Lafon s’inquiète du silence persistant des hommes. Depuis l’affaire des viols de Mazan, dit-elle, il y a eu de très beaux textes de femmes, mais peu — voire aucun — textes de figures masculines médiatiques qui s’adressent à leurs semblables. Elle y voit une occasion manquée : « Ce sujet ne peut pas être porté uniquement par les femmes. »
Dans Chavirer, dans Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce, dans Quand tu écouteras cette chanson, dans Le loup, l’épée et les étoiles (Le 1 en livre, Editions de l’Aube, 2021), tous les livres de Lola Lafon abordent de manière centrale ou latérale les violences faites aux femmes, l’exploitation des plus jeunes, et la mémoire du corps. Dans son premier roman, elle racontait déjà le parcours d’une jeune fille violée, qui allait se reconstruire dans les milieux antifascistes. À l’époque, dit-elle, les journalistes hommes y voyaient un roman politique ; les femmes, un roman sur le viol. Aujourd’hui, elle constate que le regard a changé, qu’on peut désormais lire ses textes dans leur complexité. Mais elle ne renonce pas à l’exigence : celle de la construction, celle du possible. Dans les chapitres les plus graves, l’espoir persiste. Le titre même du livre, Il n’a jamais été trop tard, est une promesse. Mais une promesse sans injonction. « Je ne dis pas aux gens : allez-y, bougez-vous. Je dis simplement que peut-être, c’est encore possible. »
La littérature, pour Lola Lafon, est ce qui prend le temps. Ce n’est pas une réaction. Ce n’est pas une opinion. « L’opinion, ce n’est pas la littérature », dit-elle sans ambages. Écrire, c’est penser lentement. C’est une forme de résistance à la saturation. C’est aussi une manière d’habiter l’inquiétude, d’habiter l’incertitude. C’est, selon ses mots, « une tentative — pas une réussite — d’attraper ce qu’on ne comprend pas ». Ce n’est pas donner une leçon, ni imposer un sens. C’est faire apparaître ce qui ne se dit pas encore. C’est convoquer le trouble, et en faire un outil de lien. Une forme de conversation, peut-être — la seule qui vaille : « On ne peut pas être en conversation avec quelqu’un en étant absolument certain d’avoir raison. Ce n’est pas une conversation. » À Blois, ce soir-là, cette conversation a eu lieu. Une vraie.