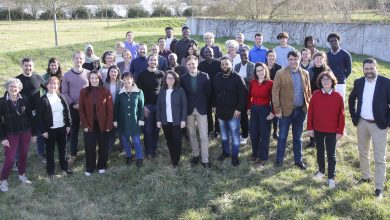Une vie à l’atelier : Junko Shibanuma raconte Bernard Lorjou

Elle était interprète au Japon. Il était peintre français, en déplacement à Tokyo. Ils ne parlaient pas la même langue, ni artistique, ni affective. Et pourtant. Junko Shibanuma a vécu dix-huit ans auprès de Bernard Lorjou, jusqu’à sa mort. Aujourd’hui encore, elle habite à Saint-Denis-sur-Loire, à quelques mètres de la maison de l’artiste. Elle continue à veiller sur son œuvre. Pas pour l’entretenir comme un mythe, mais pour en préserver la vérité nue. Celle du travail, de l’exigence, de la colère — et de la fidélité.
Tokyo, 1968. Junko Shibanuma travaille comme interprète, diplômée après un concours d’État. Le français est encore très rarement pratiqué. Bernard Lorjou vient exposer au Japon. Il a déjà renvoyé deux interprètes. Junko est la troisième. Elle ne le connaît pas. Elle hésite : poursuivre les traductions qu’elle fait à domicile, ou accepter ce nouveau client. Elle téléphone à son père, chirurgien amateur de peinture. Il répond : « Abandonne tout. Vas-y. C’est un grand peintre.
Le lendemain, elle se présente à Lorjou : « Je viens parce que mon père m’a dit que vous êtes un grand peintre. » Il ne l’a jamais oublié. Pendant toutes les années suivantes, chaque différend, chaque tension, était ramené à cette scène inaugurale : « Tu ne voulais pas travailler pour moi. C’est ton père qui t’y a forcée. »
Une vie d’atelier
L’année suivante, Lorjou invite Junko et son mari à passer quelques semaines à Saint-Denis-sur-Loire. Son mari, habile de ses mains, commence aussitôt à l’atelier. Junko s’occupe des pinceaux. Ils ne repartent pas. Lorjou leur dit : « Je vous laisse partir au Japon, mais revenez vite. » Ils reviennent. Ils restent. Elle ne peint pas, ne grave pas, mais elle est là. À l’atelier. À laver les pinceaux. À porter les seaux. À traduire. À subir. À consoler. « Il était très difficile. Même avec moi. »
Ses colères sont imprévisibles, brutales. « Quand il se mettait en rage, on ne savait pas pourquoi. Avec mon mari, on se demandait si c’était à cause du repas ! Mais souvent, on ne comprenait pas. » Junko monte alors se réfugier dans sa chambre. Elle pleure. Puis, une demi-heure plus tard, Lorjou frappe à la porte :
« Qu’est-ce que vous avez, poulet ? » Il appelait ainsi Junko et son mari : poulet. Le ton redevenait doux, enfantin. Il avait oublié. Et Junko redescendait. Elle retournait à l’atelier. « Je lavais les pinceaux. C’était comme ça. L’orage était passé. »
Une colère miroir
En 1980, un incident change l’équilibre. Une amie de sa mère, couturière japonaise, est de passage. Junko lui confie un seau de pinceaux à nettoyer. Lorjou la voit faire. Il explose. « Qui lui a demandé ça ? » Junko assume : « C’est moi. Elle insistait. » Il hurle. Junko prend un tabouret. Elle le lève. Elle ne jette pas. Mais elle le lève. Il recule. Il a peur. « Il a eu peur pour ses doigts. Parce qu’un peintre, ça a besoin de ses mains. » Elle n’avait pas l’intention de le frapper. C’était un geste d’arrêt. Mais après ça, les colères de Lorjou contre elle ont nettement diminué. En contrepartie, quelque chose se perd : « Il ne m’a plus jamais tout dit comme avant. Il s’est mis à se méfier. »
Une fureur d’époque
Junko ne cherche ni à atténuer ni à dénoncer. Elle raconte. Elle dit que la colère de Lorjou n’était jamais tournée contre les personnes. Pas contre elle. Pas contre les autres. « C’était plus grand que ça. C’était contre le monde. »
Elle cite l’épisode où Lorjou a pris publiquement position contre la construction de Beaubourg. Il criait en 1976 : « Le centre Pompidou c’est de la merde. Beaubourg dans sa forme, dans son esprit, dans sa fonction c’est de la merde, rien que de la merde, totalement de la merde ! » Il le proclamait partout. Il faisait même imprimer des pinces à linge avec cette phrase. « C’était comme une guerre. » Ce n’était pas de la provocation gratuite. C’était un engagement viscéral. Junko le dit sans pathos : « En ce sens, il m’a formée. Moi, j’étais plus gentille avant. »
Le dessin comme exutoire
Dans l’atelier, la tension restait palpable. Mais le dessin avait chez lui une fonction de décharge.
« C’était sa manière de se calmer. Il ne pouvait pas faire autrement. » Un jour, elle découvre sur son chevalet un Arlequin magnifique. Elle le complimente à table. L’après-midi, elle repasse : le tableau a été repeint en blanc. « Il m’a montré qu’il ne fallait rien dire. Il disait : ce n’est pas pour vous, c’est pour moi. »

Après lui
Depuis la mort de Lorjou, Junko vit toujours à Saint-Denis-sur-Loire. Elle continue d’organiser des expositions. Elle ne se met pas en avant. Elle témoigne. Avec une sincérité désarmante. Elle ne sacralise pas Lorjou. Elle ne le défend pas. Elle ne l’excuse pas. Elle le raconte. Et lorsqu’on lui demande pourquoi elle continue, elle répond simplement : « Parce que je ne peux pas m’en passer. » Elle est la voix de celle qui l’a supportée, dans tous les sens du mot.
Exposition à la galerie d’art Wilson jusqu’au 2 août 2025 – Entrée libre pour l’exposition à tout public, du mercredi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h – 23 avenue Président-Wilson à Blois.