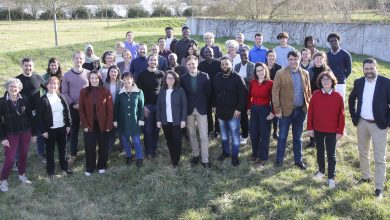Zoom sur l’enceinte médiévale de Blois

À Blois, les traces de l’enceinte médiévale passent presque inaperçues dans le paysage urbain. Et pourtant, à partir du XIIIe siècle, cette muraille a joué un rôle central dans la structuration de la ville et sa protection. Pendant plus de trois siècles, elle fut érigée, modifiée, renforcée, avant d’être peu à peu abandonnée et détruite à l’époque moderne. C’est à cette histoire méconnue que s’est intéressée Marie Lafont, dans un mémoire universitaire soutenu en 2015 sous la direction d’Alain Salamagne à l’université de Tours, et publié en 2017 dans la revue scientifique RACF.
Une construction amorcée entre 1230 et 1270
Les sources écrites antérieures au XIVe siècle sont rares. Mais deux lettres décisives, datées de 1270 et 1284, permettent de situer la construction de l’enceinte urbaine dans le 2ᵉ quart du XIIIe siècle. La première, émise par Jean de Châtillon, comte de Blois, mentionne des murs existants au nord de la ville. La seconde, adressée par la comtesse Jeanne de Blois-Châtillon aux religieux de Saint-Lomer, autorise l’agrandissement de l’enclos de l’abbaye et la réutilisation de pierres issues d’un pan de courtine, nommé « mur le Comte », déjà en place. À cette date, l’enceinte est donc en voie d’achèvement.
L’analyse des vestiges architecturaux, des archères et des plans anciens – notamment le cadastre napoléonien de 1810 – confirme cette datation. Le tracé originel de l’enceinte, lit-on, adoptait la topographie du site, englobait les principaux pôles urbains, et mesurait 2,2 km de périmètre pour une surface protégée de 20 hectares, comparable à celle de villes comme Vendôme ou Amboise.

Une ville protégée par seize tours et onze portes
L’enceinte comprenait au moins seize tours et onze portes, réparties sur cinq fronts défensifs. Le front nord, relativement bien conservé, allait de la porte Chartraine jusqu’à la tour des Rouillis. La porte Chartraine était l’entrée principale de la ville. Le front est longeait la Loire, avec notamment la tour des Poudres et les portes Saint-Jean, Maréchal et Clouseaux. À l’ouest, l’enclos de l’abbaye Saint-Lomer se trouvait intégré au rempart.

Les tours conservées (rue Gallois, tour des Cordeliers, tour des Rouillis) sont essentiellement de plan circulaire, modèle qui s’impose à partir du XIIIe siècle pour éviter les angles morts. Seules trois sont de plan quadrangulaire, toutes liées à des enclos religieux. Ces tours étaient percées d’archères à étrier triangulaire, caractéristiques du style Plantagenêt diffusé dans la région à partir des années 1240. Le mur d’enceinte, ou courtine, mesurait entre 1,5 m et 1,7 m d’épaisseur. Quant aux fossés, un sondage archéologique effectué en 2008 dans les jardins de l’Évêché a mis en évidence une tranchée défensive de 18 mètres de large pour plus d’1,5 m de profondeur.

Renforcements sous la guerre de Cent Ans
À partir de 1356, la guerre de Cent Ans touche le Blésois. La ville engage alors d’importants travaux de renforcement : fourniture de bois, construction de nouveaux fossés, réparations des ponts, perception d’un impôt exceptionnel. Les archives municipales et royales confirment que des sommes importantes ont été allouées par la commune pour financer ces « emparements ». Plusieurs barrières sont également érigées à partir de 1413 pour fermer les faubourgs (Bourgneuf, Saint-Jean, Foix, Vienne).
Une adaptation partielle à l’artillerie
La principale innovation défensive du XVe siècle est l’arrivée de l’artillerie à feu. À Blois, elle n’apparaît qu’à partir de 1418, date d’un inventaire des bouches à feu du château. Par la suite, des pièces sont envoyées à Beaugency ou Chambord, et des munitions sont distribuées aux garnisons du comté.
Sur l’enceinte urbaine, seule la tour des Rouillis, datée du début du XVe siècle, témoigne d’une adaptation à cette nouvelle technologie. Elle possède des murs épais de 2,30 m, un diamètre de 9,80 m, et des arbalétrières-canonnières, permettant un usage mixte de l’arbalète et de petites pièces à feu. Cette modernisation reste cependant très ponctuelle : les autres tours n’ont pas été modifiées.
L’abandon progressif et la destruction
Dès la fin du XVIe siècle, l’enceinte n’est plus entretenue. Les fossés sont comblés, des brèches apparaissent, et des ouvertures non contrôlées sont percées. Les documents municipaux des années 1560 témoignent d’un état d’abandon avancé. Lors des guerres de Religion, deux petits éperons sont ajoutés aux angles sud, mais ils sont vite jugés inutiles.
Entre le XVIIe et le XIXe siècle, les destructions s’enchaînent :
- 1716 : écroulement du pont médiéval, entraînant la démolition partielle du front de Loire.
- 1778 : disparition de la tour des Poudres.
- 1783–1790 : suppression des portes Foix, Chartraine, Maréchal, Neuve.
- 1818 : une tour de la rue Gallois est détruite.
- 1950 : construction d’une école rue Trouessart, avec destruction d’une seconde tour des Cordeliers.
Aujourd’hui, seuls quelques pans de mur et tours subsistent.
La Tour Beauvoir
La tour Beauvoir, mentionnée comme donjon dès le XIIIe siècle, est l’un des rares vestiges médiévaux encore visibles dans le tissu urbain de Blois. Située dans la zone nord de la ville ancienne, elle précède la construction de l’enceinte urbaine, à laquelle elle est intégrée au moment de l’extension des fortifications dans le 2e quart du XIIIe siècle.

Une origine seigneuriale avant 1256
Avant de devenir un élément de la défense comtale, la tour Beauvoir était au cœur d’un fief noble appartenant aux seigneurs de Beauvoir, probablement lié à une fonction résidentielle et défensive. Le site est mentionné dans les documents comme étant cédé aux comtes de Blois en 1256, ce qui marque son passage d’un usage privé à un rôle stratégique dans le système urbain.
Une intégration dans l’enceinte médiévale
Avec la construction de l’enceinte entre 1230 et 1284, le donjon de Beauvoir est intégré au tracé nord de la muraille, entre la porte Chartraine et l’enclos des Cordeliers. Il devient alors un point fortifié de premier plan, servant à la surveillance et à la dissuasion militaire. Son plan est rectangulaire, et les maçonneries visibles aujourd’hui témoignent de remaniements successifs entre le XIIIe et le XVe siècle.
Une reconversion carcérale au XIVe siècle
À partir du XIVe siècle, la tour Beauvoir est aménagée en prison, usage qu’elle conserve pendant plusieurs siècles. Elle sert notamment de lieu de détention pour des criminels de droit commun ou des détenus liés aux conflits locaux. La tour aujourd’hui n’est plus visitable mais est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1929.